|
Born fi' dead : sur
la piste des gangs
jamaïcains, de Kingston à New York / Laurie
Gunst ; trad. de l'anglais
par Thibault Ehrengardt. - Nogent-sur-Marne : Natty Dread,
2009. -
VIII-171 p. ; 21 cm. - (Jamaica insula).
ISBN
978-2-9533982-1-2
|
|
Cette
île a une histoire dense qui a cristallisé en son
sein
chaque révolution de l'Occident. Les
sociétés
primitives dévastées par la conquête
européenne, l'extermination des indigènes
remplacés par les esclaves africains, le long sommeil du
colonialisme et la lente et douloureuse ascension vers la
souveraineté. C'est une petite île, aiment dire
les
Jamaïcains de leur pays montagneux, mais
l'intérieur est
profond comme l'enfer. Son histoire est à l'aune de cette
description.
☐ Laurie
Gunst, Introduction,
p. V |
Au
lendemain d'une indépendance concédée
(en 1962)
sans que les séquelles de l'esclavage et du colonialisme
aient
été résorbées, et sans
qu'aient
été mises en place les bases d'un
développement
équilibré, la société
jamaïcaine est
tombée sous la coupe de deux factions politiques violemment
antagonistes : la première fascinée par
les
Etats-Unis, perméable aux pires excès du
capitalisme
libéral et aux obsessions para-sécuritaires de la
CIA, et
la seconde rêvant de l'utopie castriste qui fleurissait
à
Cuba.
Pour contrôler leurs
sphères d'influence
réciproques, les leader politiques de chaque camp se sont
rapidement entourés de milices recrutées dans les
ghettos
où les jeunes sufferers
— pauvres d'entre les pauvres —
pensaient trouver
une forme d'émancipation dans la violence. L'usage des armes
à des fins politiques ou économiques s'est
très
rapidement banalisé, au prix d'effroyables
résultats.
Puis les posses, ces
gangs
asservis aux pouvoirs, ont élargi et diversifié
leurs
champs d'activités, notamment dans le commerce des
drogues ; les plus actifs se sont alors rapprochés
des
lieux de consommation investissant les grandes métropoles du
continent américain, New York en particulier. Que ce soit en
Jamaïque ou sur le territoire des Etats-Unis, dans
l'accompagnement de menées politiciennes ou dans le commerce
de
la drogue, les posses
jamaïcains se signalent par leur implacable
brutalité.
Laurie
Gunst a mené une longue et minutieuse enquête,
dans les
ghettos de Kingston et dans certains quartiers de New York. Son
témoignage est précisément
documenté. Les
portraits qu'elle trace de plusieurs membres de ces gangs sont riches
d'information et particulièrement
équilibrés : sans complaisance, elle
évoque
le parcours d'enfants dévoyés auxquels les
policiers qui
les traquent finissent par s'attacher, à l'image de Bill
Fredericks, agent de l'ATR (Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms),
qui éprouvait
beaucoup de
tristesse lorsqu'il pensait à la manière dont ces
gamins
avaient gâché leur vie :
« Lorsque tu les
mets face à leurs actes, parfois, ils craquent et se mettent
à pleurer. Ils disent avoir été
élevés en bons chrétiens et tu vois
bien qu'ils
auraient pu vivre autre chose ».
NOTE
DE L'ÉDITEUR : Titulaire d'un doctorat
(Harvard) et d'un diplôme de journalisme (Columbia), Laurie Gunst côtoie
intimement les gens dont elle décrit le destin. Depuis les
allées décharnées de Southside
où elle
passe plusieurs mois au contact des sufferers
(les pauvres d'entre les pauvres qui luttent pour leur survie),
jusqu'aux baraques à crack de Brooklyn, elle livre
l'histoire
des puissants tout en traquant ses répercussions sur la vie
de
ceux qui se retrouvent pris au piège d'un système
brutal
et implacable.
|
| EXTRAIT |
L'état de l'économie du pays, dans les
années 60, renforçait à la fois
l'espoir et la
désillusion. La bauxite et le tourisme étaient en
plein
boom mais cela ne changeait pas grand-chose au quotidien des gens. Les
usines de bauxite appartenaient à de grands groupes
internationaux comme Kaiser, Revere ou Reynolds Metals et s'ils
versaient les meilleurs salaires de l'île, cela ne faisait
que
favoriser l'apparition d'une espèce d'aristocratie de
travailleurs qui rendait plus évidente encore la
pauvreté
des petits fermiers et des peons qui suaient dans les champs de canne
à sucre.
Le tourisme se montrait un corrosif
social encore plus actif. Il fournissait des emplois saisonniers et mal
payés à quelques personnes qui vivaient dans les
petites
villes de la côte nord mais ces emplois
répondaient
à un atavisme fantasque : le Jamaica Tourist Board
souhaitait que chaque visiteur blanc ait l'impression, en
débarquant en Jamaïque, d'atterir dans le vieux sud
d'Autant en emporte le
vent. L'un de ses dépliants publicitaires
vantait la douceur de vivre à la jamaïcaine :
Vous
pouvez louer une vie magique en Jamaïque. Il y a des
villas-à-louer, des cuisiniers-à-louer, des
servantes-à-louer, des nounous, des jardiniers. Cela
débute dans une maison à l'intérieure
des terres
ou un havre perché au sommet des collines, où des
gens
aimables aux doux noms d'Ivy, Maud ou Malcolm cuisineront pour vous,
seront aux petits soins et veilleront à ce que tout se passe
bien. Ils changeront les couches de vos enfants, s'occuperont de votre
linge, vous donneront du « Monsieur Peter, s'il vous
plaît … », vous
gâteront avec des
tartes à la coco faites maison, vous admireront lorsque vous
serez à votre avantage et riront à vos blagues
avant de
pleurer lors de votre départ.
En fait, Ivy, Maud et Malcolm vivaient dans des taudis d'une
détestable crasse et leurs enfants,
dévorés par le
rachitisme, fixaient le vide à longueur de vie au fond de
cours
crasseuses. Ils faisaient des kilomètres pour venir
travailler
dans les hôtels, chapardant les restes des clients dans les
poubelles, puis ils rentraient chez eux, le long de routes
éprouvantes tandis que les touristes les
dépassaient
à vive allure dans des voitures étincelantes.
Alors s'il
arrivait à Ivy, Maud et Malcolm de pleurer, ce
n'était
pas de les voir partir.
Pas une once des richesses
générées par la bauxite et le tourisme
ne
parvenait à Kingston. La ville enflait chaque jour,
surchargée de nouveaux arrivants qui avaient
laissé leur
campagne derrière eux pour se ruer sur la ville qu'ils
imaginaient regorgeant de jobs, d'habitations propres,
bénéficiant de l'eau courante et d'un
réseau de
transports. Pour tomber sur des dungles,
des
décharges et des terrains vagues
aménagés en bidonvilles sur le front de mer de
Kingston ouest.
☐ pp. 51-52 |
|
| COMPLÉMENT
BIBLIOGRAPHIQUE |
- « Born
fi' dead : a journey through the Jamaican posse
underworld » New York : Henry Holt, 1995
|
|
|
| mise-à-jour : 13
décembre 2010 |
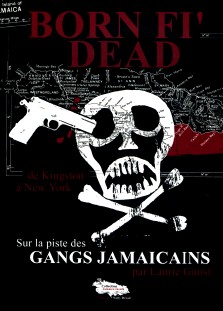
|
|
|
|