|
Conjurer
la guerre : violence et pouvoir à Houaïlou
(Nouvelle-Calédonie) / Michel Naepels. - Paris :
École des hautes études en sciences sociales,
2013. -
287 p. : ill. ; 24 cm. - (En temps
& lieux, 41).
ISBN 978-2-7132-2376-1
|
|
On peut … lire le titre de cet
ouvrage, Conjurer la
guerre,
en une double acception, tenant compte de la polysémie du
terme
“ conjuration ”, laquelle nous
semble bien
décrire l'ambivalence des rapports sociaux et politiques
kanak
que nous souhaitons mettre en lumière ici. En un premier
sens,
nous essayerons de comprendre quelle place est faite à la
violence physique à Houaïlou, et dans quelle mesure
les
conflits locaux suscitent des interventions destinées
à
éviter qu'ils ne
dégénèrent, pour
empêcher la guerre et contrôler la violence. Mais
en un
second sens, nous opposerons à cette perspective
juridico-philosophique centrée sur la
souveraineté, la
chefferie, la contractualisation et l'ordre des espaces de
corésidence, qui est aussi celui des discours
cérémoniels publics kanak, un sens frondeur,
accentuant
alors les dimensions historiques et politiques de la
réalité sociale. On comprendra que l'on peut
conjurer la
guerre comme des conjurés, comme des frondeurs, comme des
brigands … en préparant la guerre en
secret.
☐
Introduction,
pp. 12-13 |
NOTE DE L'ÉDITEUR :
Quel est le fil conducteur qui mène un anthropologue
enquêtant à Houaïlou, en
Nouvelle-Calédonie,
à s'intéresser à la fois aux
opérations de
répression coloniale menées en 1856, à
la chasse
anti-sorciers de 1955, à la mobilisation
indépendantiste
des années 1980 et aux règlements de compte
villageois
des années 2000 ? La violence, le conflit, la
guerre.
Autrement dit, quelles sont les conventions d'usage de la
violence ? Comment contrôler la violence pour
éviter
la guerre, ou pour la préparer en secret ?
Michel
Naepels décrit et analyse les pratiques
guerrières, les
figures du massacre, la question de l'anthropophagie, les
“ objets de guerre ”.
À travers cette
archéologie de la violence, il rend compte de
l'inventivité pratique, de l'intelligence et de la ruse des
Kanaks impliqués dans des rapports conflictuels, souvent
violents. Les archives et le recours aux récits recueillis
auprès des habitants actuels de Houaïlou restituent
l'épaisseur de ces moments historiques, les contextes
emboîtés de l'action politique qui s'y
déploie,
tout en interrogeant la valeur et les limites de l'enquête de
terrain.
Ces épisodes sont autant de séquences de
changement dans l'organisation sociale, administrative,
foncière
ou politique : ils permettent de comprendre, depuis la prise
de
possession par la France jusqu'à nos jours, les
modalités
réelles de mise en œuvre de la
gouvernementalité
coloniale et postcoloniale. L'attention portée à
l'invention, à l'importation ou à l'adaptation
des
techniques répressives, massivement liées
à
l'expérience française en Algérie,
ouvre à
une véritable géopolitique de la colonisation.
À
travers cette description minutieuse des logiques sociales du conflit,
Michel Naepels invite aussi à une réflexion sur
la place
des fantasmes européens sur la violence ethnique, sur les
représentations de
l'altérité.
|
| SOMMAIRE |
Introduction
Chapitre
1 — Concurrence lignagère et
contrôle colonial. Les dynamiques de la guerre dans un espace
mondialisé
1847-1855 – Les santaliers,
“ Houaïlou ” et le
système-monde océanien
Octobre 1855-mars 1856
– Les chercheurs d’or, Canala et le
système-monde européen
10 juillet
1856 – La guerre
1857-1878 –
L’alliance avec les Français,
l’investissement auxiliaire
1875-1881 –
Contrôle local et mondialisation
Guerres et
constitution des chefferies : une relecture des sources
coloniales
Chapitre
2 — Les objets de la guerre
Les pierres de guerre
L’histoire
d’une guerre
Pierres de guerre et
conversion : l’exemple de
Bwêêyöuu Ërijiyi
Les collecteurs
Chapitre
3 — Les chefferies dans l’ordre
colonial
La mise en ordre des chefferies
Ordre sanitaire et
guerre kanake
L’invention
différée du conseil des anciens
Chapitre
4 — Mobilisations au sortir de
l’Indigénat
1945-1954 – Réforme
administrative et mobilisation protestante
1955 – Une
chasse aux sorciers
1957-1960 –
Dynamiques de la scission
Chapitre
5 — Subjectivité de
l’action violente
Les
“ événements ” :
mobilisations collectives et actions solitaires
Émotions
politiques
Chapitre
6 — Construction et fiction du consensus
Politiques cérémonielles
Quatre espaces de
mobilisation après l’Accord de Nouméa
Conclusion
Bibliographie, Table des figures
|
|
| COMPLÉMENT
BIBLIOGRAPHIQUE |
- « War
and other means : violence and power in Houaïlou (New
Caledonia) » translated by Rachel Gomme, Canberra : ANU
Press (State, society and governance in Melanesia), 2017
|
- Michel
Naepels, « Ethnographie, pragmatique,
histoire : un
parcours de recherche à Houaïlou,
Nouvelle-Calédonie », Paris :
Publications de la
Sorbonne (Itinéraires), 2011
- « Terrains
et destins de Maurice Leenhardt » sous la dir. de
Michel
Naepels et Christine Salomon, Paris : École des
hautes
études en sciences sociales, 2007
- « Les
rivages du temps : histoire et anthropologie du
Pacifique » textes réunis par Isabelle
Merle et
Michel Naepels, Paris : L'Harmattan (Cahiers du Pacifique Sud
contemporain, 3), 2003
- « Partir
à Nouméa : remarques sur les migrants
originaires de
la région ajië » in Alban Bensa
et Isabelle
Leblic, En pays kanak :
ethnologie, linguistique, archéologie, histoire de la
Nouvelle-Calédonie, Paris : Ed. de
la Maison des sciences de l'homme (Ethnologie de la France), 2000
- Michel
Naepels, « Histoire de terres kanakes :
conflits
fonciers et rapports sociaux dans la région de
Houaïlou
(Nouvelle Calédonie) », Paris :
Belin
(Socio-histoires), 1998
|
|
|
| mise-à-jour : 24
novembre 2021 |
|
|
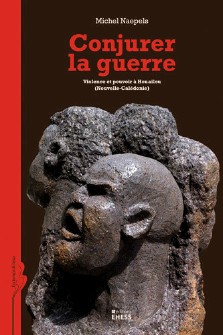 |
|
|
|