|
R.U.R.
Rossum's universal robots : drame collectif en un prologue de
comédie et trois actes / Karel Čapek ; traduit du
tchèque par Jan Rubeš ;
préface par Brigitte
Munier. - Paris : La Différence, 2011. -
219 p. ;
17 cm. - (Minos, 81).
ISBN
978-2-7291-1922-5
|
|
Vous
croyez encore que c'est le patron qui dirige l'entreprise ?
Non ! C'est l'offre et la demande qui commandent !
Tout le
monde voulait avoir son robot. Et nous avons donné juste un
coup
de pouce à cette boule de neige avec nos discours sur la
technologie moderne et sur le progrès. Alors qu'elle roulait
toute seule, et de plus en plus vite. Avec chaque sale commande elle
devenait plus grande et plus difficile à arrêter.
C'est
ça, chers amis.
☐ Acte II,
p. 158 |
Figure majeure de la littérature tchèque,
Karel Čapek
(1890-1938) doute des bienfaits de la civilisation ; c'est
l'impression qui s'impose à la lecture de ses “ utopies insulaires ”.
Dans La guerre des salamandres (Válka s mloky, 1936),
des hommes dressent un groupe de salamandres découvertes au
large des côtes indonésiennes en vue de
l'exploitation intensive d'un gisement de perles jusqu'au moment
où ces « bêtes
intelligentes et confiantes » se
révoltent. Le héros de R.U.R.
poursuit le rêve qui animait le docteur Frankenstein ou le docteur Moreau ; dans la
pièce, cette préhistoire est
évoquée au travers de la figure du vieux Rossum.
Mais Čapek (comme, dans un autre registre, Xavier de Langlais),
va plus loin que ses prédécesseurs ; le vieux Rossum qui,
au prologue, entreprend de « faire un homme » est
vite dépassé
par son rêve, et c'est une équipe aux ambitions
plus prosaïques — un
homme d'affaires, des ingénieurs et un
comptable — qui prend le relai.
Le nouvel objectif est de créer un androïde sans
états
d'âme, un travailleur efficace et rentable, un robot 1 … Mais, les robots, comme
les salamandres, finissent par se rebeller et exterminent
l'espèce
humaine. Un clin d'œil relativise le
dénouement, en évoquant
non sans ironie le mythe du Golem et la Genèse 2.
L'île
qui sert de cadre à ces événements
peut faire écho à l'Eden
perdu ; c'est encore un lieu d'élection pour les
délires expérimentaux
des apprentis sorciers (comme chez Huxley
ou Wells) ; c'est
enfin le
piège où se laisseront prendre sans
possibilité de retrait des
protagonistes aussi mal avisés qu'imprévoyants.
| 1. |
Néologisme créé
par Karel Capek à partir du tchèque robota : travail
ou, plus précisément, corvée. |
| 2. |
Cf. la préface de Brigitte Munier. |
|
| EXTRAIT |
DOMIN
Je vous montrerai au musée tout ce que Rossum a
bricolé en dix ans. Il voulait faire un homme, ça
a
survécu à peine trois jours. Le vieux n'avait pas
le
moindre goût. Il a fabriqué un
épouvantail qui
avait à l'intérieur tout ce qu'il faut
à l'homme.
Un vrai travail de bénédictin. C'est alors qu'est
venu
ici l'ingénieur Rossum, le neveu du vieux. Un petit
génie
mademoiselle. Quand il a vu tout ce gâchis, il a dit au
vieux : « Fabriquer un homme pendant dix
ans est
insensé. Si tu ne le fais pas plus vite que la nature,
ça
ne vaut pas la peine d'y perdre son temps. » Et il
s'est
lancé dans l'anatomie.
HÉLÈNE
Pourtant, dans les livres, on
dit autre chose.
DOMIN se
lève.
Dans les livres, c'est de la publicité et
ça n'a
aucun sens. On y dit par exemple que les robots ont
été
inventés par le vieux monsieur. Il aurait pu enseigner
à
l'université mais il n'avait pas la moindre notion de la
production industrielle. Vous savez, il s'imaginait qu'il allait
fabriquer de vrais hommes, de nouveaux Indiens ou des professeurs ou
des idiots. Ce n'est que le jeune Rossum qui a eu l'idée
d'en
faire des machines intelligentes et vivantes. Tout ce qu'on raconte sur
la collaboration des deux Rossum, c'est de la blague. Ils ne cessaient
de se bagarrer. Le viel athée n'a jamais compris ce que
c'est
que la production industrielle et le jeune a du l'enfermer dans son
laboratoire où il a continué à
fignoler ses
avortons ; et il s'est mis à produire
lui-même les
robots industriels. Le vieux le maudissait, il a pondu encore deux ou
trois monstres et on l'a trouvé mort dans son labo.
Voilà
toute l'histoire.
HÉLÈNE
Et le jeune ?
DOMIN
Le jeune, mademoiselle, c'était l'ère
nouvelle.
L'ère de la production qui a suivi l'ère du
savoir. Il a
un peu regardé l'anatomie humaine et il tout de suite
compris
que c'était trop compliqué et qu'un bon
ingénieur
pourrait le faire plus simplement. Il a repris l'anatomie, il a
essayé de se passer de ceci ou de cela, de simplifier ici et
là … Bref … est-ce
que je ne vous ennuie
pas ?
HÉLÈNE
Au contraire, je trouve cela
très intéressant.
DOMIN
Alors le jeune Rossum s'est dit : Un homme,
ça
ressent par exemple de la joie, ça joue du violon,
ça a
envie de se promener, bref il y a tant de choses qui sont, au fond,
inutiles.
HÉLÈNE
Oh non !
DOMIN
Attendez un peu. Qui sont inutiles lorsqu'on doit, disons,
tisser
ou calculer. Un moteur diesel ne doit pas nons plus avoir des franges
ou des ornements, mademoiselle Glory. Et fabriquer les ouvriers
artificiels, c'est la même chose que de fabriquer les moteurs
diesel. La production doit être simplifiée au
maximum et
le produit le meilleur possible. Que pensez-vous, quel est le meilleur
ouvrier possible ?
HÉLÈNE
Le meilleur ? Probablement celui
qui …
qui … est honnête …
et
dévoué.
DOMIN
Non. Celui qui coûte le moins cher. Celui qui exige
le
moins. Le jeune Rossum a mis au point l'ouvrier qui a le minimum
d'exigences. Il l'a simplifié. Il l'a
débarrassé
de tout ce qui n'est pas absolument nécessaire pour qu'il
travaille. Ainsi, à force de simplifier l'homme, il a
créé le robot.
☐ Prologue,
pp. 29-31 |
|
| COMPLÉMENT
BIBLIOGRAPHIQUE |
- « RUR,
Rossum's universal robots : Kolektivní drama o
vstupní komedii a trech aktech »,
Prague :
Vydalo Aventinum, 1920
- «
R.U.R., comédie utopiste en trois actes et un prologue
»
traduit du tchèque par Hanuš Jelinek,
Paris :
Jacques Hébertot, 1924
- « R.U.R. [suivi
de] Le dossier Makropoulos [et de] La maladie blanche »
traduit du tchèque par Jan Rubes, La Tour
d'Aigues : Ed. de l'Aube (Regards
croisés), 1997
- Katerina Cupova, « R.U.R., le soulèvement des robots » d'après l'œuvre de Karel Čapek, Boulogne-Billancourt : Glénat, 2022
|
- « La
guerre des salamandres » trad. du tchèque
par Claudia
Ancelot, Paris : Messidor, 1990 ; Paris :
Ibolya
Virág, 1996 ; Chêne-Bourg
(Genève) : La
Baconnière, 2012 ; Paris : Cambourakis,
2012
- « Voyage
vers le Nord » trad. du tchèque par
Benoît
Meunier, Paris : Ed. du Sonneur, 201
|
|
|
| mise-à-jour : 10 mai 2022 |
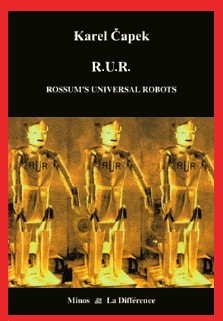 |
|
|
|