|
Résistances et
révoltes contre les pouvoirs établis de
l'Antiquité à nos jours [congrès du
CARDH, octobre 2002] / sous la dir. de Lucien Abénon, Nenad
Fejic et Annie Saulnier. - Matoury (Guyane) : Ibis rouge,
2004. - 295 p. : ill. ; 24 cm. - (Espace
outre-mer).
ISBN 2-84450-196-6
|
Le
seul hasard a-t-il voulu que les actes de ce
congrès s'ouvrent sur une communication où l'on
voit l'île de Samos relever, face à
Athènes, les principes de la démocratie
menacés par la révolution oligarchique de 411
— montrant entre autres, par ce geste, que la
cité n'est pas synonyme d'un territoire
déterminé, mais une “ communauté
humaine dissociable de son support
territorial ” ?
Relaté par Thucydide 1,
l'épisode introduit
un ensemble de questions qui s'inscrivent en filigrane dans le cours du
recueil et contraignent à une lecture renouvelée
du jeu toujours réactivé entre pouvoir(s) d'une
part, résistances et révoltes
d'autre part ; sont ainsi interrogés les fondements
politiques et sociaux du pouvoir, son assise géographique,
la légitimité et la portée effective
des concepts de “ centre ” et de
périphérie, etc.
Des diverses formes que peut prendre la
résistance passive — errance,
désertion, fuite, exil — à la
révolte armée, les réponses
apportées au pouvoir, à ses excès
réels ou supposés comme à ses
dévoiements, sont nombreuses et sont ici abondamment
décrites, commentées et analysées.
À l'évidence les
milieux insulaires — lieux de pouvoir ou tributaires d'un
pouvoir extérieur — fournissent un cadre
approprié pour l'approfondissement de la
réflexion, comme si s'y exerçait un
“ effet de loupe ”, non seulement
au bénéfice de l'observateur, mais
également (surtout ?) au
bénéfice ou au détriment des
protagonistes ; c'est ce que montre clairement l'exemple de
Samos, non moins que les nombreux exemples tirés du monde
caraïbe et réunis dans la troisième
partie.
| 1. |
«
Histoire de la guerre du
Péloponnèse »
[tome 5, Livre VIII] texte établi et
traduit par
Raymond Weil avec la coll. de Jacqueline de Romilly, Paris :
Les
Belles lettres (Collection des universités de France), 1972 |
|
|
NOTE
DE L'ÉDITEUR : Y-a-t-il une
marche de l'Histoire ? Peut-être ! En tout
cas si c'est le cas il est évident que cette marche est
faite d'avances et de reculs, de progrès et de
régressions. Et dans cette dynamique les révoltes
et les résistances contre les pouvoirs établis
ont eu un rôle décisif. C'est ce qui a conduit le
CARDH (Centre antillais de recherches et de documentation historiques)
de l'université des Antilles et de la Guyane à
proposer ce thème de réflexion à des
chercheurs et des universitaires. Dès le début
nous avons envisagé ce sujet comme permettant des approches
très différentes embrassant un champ historique
très large.
La vingtaine de communications
que nous avons réunies nous permettent d'avoir une vision
mondiale du phénomène puisqu'elle nous ont
conduits en France et en Espagne, dans l'Empire ottoman et en Afrique.
Le continent américain s'est taillé la partie
belle puisque nos chercheurs se sont intéressés
au Canada, au Venezuela, au Brésil et aux colonies anglaises
d'Amérique du Nord qui vont constituer les
États-Unis. Dans ce domaine la région
Caraïbe n'a bien sûr pas été
oubliée et Cuba, Saint-Domingue, la Guyane, la Martinique et
la Guadeloupe n'ont pas échappé aux
investigations de nos chercheurs.
❙
Lucien-René Abénon (1937-2004) a
enseigné
l'histoire moderne à l'Université Antilles-Guyane
de 1987
à 2002.
|
SOMMAIRE
(extrait) |
Préface
Première
partie : Résistances et révoltes en
Europe
- Christian
Bouchet, Samos 411 ou les deux Athènes (le
rôle politique des marins de la Paradienne)
- Annie
Saunier, Le blasphème et le sacrilège
face aux pouvoirs établis : tentative de
comparaison entre les derniers siècles du
Moyen-Âge et les temps modernes aux Antilles
Deuxième
partie : Résistances et révoltes, l'aire
américaine et africaine
Troisième
partie : Résistances et révoltes dans le
monde caraïbe
- Milka
Valentin Humbert, La résistance face à
Trujillo en République dominicaine
- Frédéric
Lefrançois, Révoltés
serviles dans la littérature de la Caraïbe
anglophone : Cambridge de Caryl Phillips
- Jean-Louis
Joachim, Les évènements de 1933
à Cuba : de la révolte à la
révolution
- Laurent
Jalabert, Le mythe de la révolution cubaine ches
les intellectuels français, histoire et mémoire
(1959 à nos jours)
- Léo
Elisabeth, Résistances et révoltes face
aux conditions d'application de la première
émancipation (1793-1802)
- Abel
Louis, L'affaire de la Grande Anse en décembre
1833 à la Martinique
- Lucien
Abénon, Les émeutes de 1967
à la Guadeloupe vues par le journal Le Monde
Conclusions
|
|
| COMPLÉMENT
BIBLIOGRAPHIQUE |
- Lucien
Abénon, « La Guadeloupe de 1671
à 1759 : étude politique, économique
et sociale », Paris : L'Harmattan, 1987
- Liliane
Chauleau (dir.), Jacques de Cauna et Lucien Abénon,
« Antilles 1789 : la révolution
aux Caraïbe », Paris : Nathan, 1989
- Lucien
Abénon et Maïotte Dauphite,
« Les Guadeloupéens
réfugiés à Saint-Pierre de 1794
à 1796 : en marge de l'épopée
de Victor Hugues », Le Carbet
(Martinique) : Centre d'art Musée Paul Gauguin, 1990
- Lucien
Abénon, « Petite histoire de la
Guadeloupe », Paris : L'Harmattan, 1992
- Lucien
Abénon, « L'activité du port
de Saint-Pierre, Martinique, à la fin du XIXe
siècle », Paris : L'Harmattan,
1996
- Lucien
Abénon et Henry E. Joseph, « Les
dissidents des Antilles dans les Forces françaises libres
combattantes, 1940-1945 », Fort-de-France :
Association des dissidents de la Martinique, 1999
- Lucien
Abénon et Nenad Fejic (dir.), « La Caraïbe et
son histoire : ses contacts avec le monde extérieur »,
Matoury (Guyane) : Ibis rouge, 2001
|
- Jean
Bernabé et Serge Mam-Lam-Fouck (dir.),
« Sur les chemins de l'histoire
antillaise : mélanges offerts à Lucien
Abénon », Matoury (Guyane) :
Ibis rouge, 2006
|
|
|
| mise-à-jour : 9
juin 2017 |
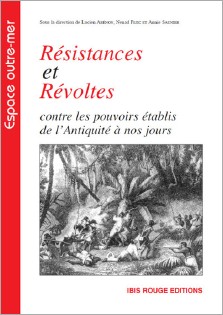
|
|
|
|