8ème édition
du Prix du Livre Insulaire (Ouessant 2006)
ouvrage sélectionné |
|
Naufragés
/ Pietro Querini, Cristoforo Fioravante et Nicoló de Michiel
;
trad. du vénitien et postfacé par Claire Judde de
Larivière. - Toulouse : Anacharsis, 2005. - 93 p. ; 20 cm.
ISBN 2-914777-20-5
|
|
Le 25 avril 1431, la nef vénitienne Querina
quitte le port de Candie en Crète à destination
des Flandres avec à son bord soixante-huit hommes et une
cargaison de Malvoisie et de bois. Après avoir
traversé la Méditerranée d'est en
ouest sans difficulté majeure, la Querina
heurte un récif à l'entrée du port de
Cadix et doit faire relâche durant près d'un mois
et demi. Fin-août, la Querina fait son
entrée à Lisbonne d'où elle repart
fin-septembre ; un mois plus tard elle fait
une ultime escale de deux jours à Muros en Galice, le temps
pour Pietro Querini et treize membres de son équipage d'une
rapide visite à Saint Jacques de Compostelle.
Ayant traversé le golfe de Gascogne, la
Querina se prépare
à entrer en Manche quand une violente tempête se
lève 1. Commence une interminable et harassante
dérive ; vents et courants contraignent la nef
à contourner l'Irlande puis la poussent toujours plus au
nord vers la mer de Norvège. Le 17 décembre,
constatant le délabrement de la nef, l'équipage
embarque à bord des deux chaloupes du bord —
« ce jour-là, vers 22 heures, sachant
qu'entre deux malheurs, il vaut mieux choisir le moindre, nous
décidâmes de quitter l'océan de feu
pour entrer dans la fournaise » (Cristoforo
Fioravante et Nicolò de Michiel). La nuit a tôt
fait de séparer les deux embarcations ; plus tard,
les survivants croiront trouver les débris de
l'ossature et des varangues de l'autre esquif :
« nous eûmes alors la certitude que les
compagnons qui y avaient embarqué la nuit où nous
nous étions séparés étaient
morts noyés » (Cristoforo
Fioravante et Nicolò de Michiel).
Le 3 janvier 1432, les rescapés
aperçoivent une île et, trois jours plus
tard, ils peuvent enfin mettre pied à terre :
« le 6 janvier, le jour solennel de la
pâque de l'Épiphanie, nous fûmes
dix-huit à débarquer dans ce lieu
désert et aride appelé l'île des
Saints, située sur la côte de la
Norvège et soumise à la couronne de
Dacia » (Cristoforo Fioravante et Nicolò
de Michiel). Mais l'île des Saints —
Sandøy — n'est qu'un îlot
désert à l'extrême sud de l'archipel
des Lofoten, au-delà du cercle polaire arctique. En plein
hiver, la robinsonnade des marins vénitiens tient du
cauchemar ; ils ne sont plus que onze quand, un mois plus
tard, des pêcheurs de l'île voisine de
Røst viennent les arracher à leur
précaire asile. Les six semaines qui suivent voient
s'inverser le sort cruel des naufragés qui croient avoir
atteint le premier cercle du paradis. Ils sont
ensuite conduits sur le continent d'où ils peuvent regagner
Venise, les uns par l'Angleterre, les autres par l'Allemagne.
Deux témoignages subsistent de
l'aventure de la Querina ; le premier sous
la plume de Pietro Querini, armateur et capitaine de la nef, le second
attribué à deux marins, Cristoforo Fioravante et
Nicolò de Michiel. Au-delà de divergences
factuelles rares et sans grande portée, ces textes mettent
en lumière la violence de l'épreuve et, par
contraste, l'acuité et surtout la fraîcheur du
regard porté sur le monde radicalement différent,
aux yeux de ces méditerranéens, d'une
communauté de pêcheurs aux lointaines Lofoten
— dans la forme, dans le choix même de certains
mots, dans le contenu et l'intention d'ensemble du propos s'entend
comme un écho annonciateur d'une littérature
utopisante encore à venir (L'Utopie de
Thomas More ne paraît qu'en 1516).
| 1. |
Pietro Querini :
“ Le 5 novembre (…) la perfide
tempête se renforça, de même que la
puissance et l'impétuosité des vents, et nous
dérivâmes jusqu'au nord des îles de
Scilly ” ; Cristoforo Fioravante et
Nicolò de Michiel : “ Le 9
novembre (…) alors que le navire avait
déjà subi de nombreuses mésaventures,
il approcha enfin de l'embouchure des canaux de Flandres. Mais une
tempête l'en éloigna d'environ 140 milles, en
direction de l'île d'Ouessant ”. |
|
| EXTRAITS |
|
Pietro Querini : Cette île [Røst]
se trouve à 70 milles au nord du cap de la
Norvège — un lieu éloigné et
extrême — et dans leur langue, ils l'appellent
« le cul du monde ». Elle est peu
vallonnée, généralement au
même niveau que la mer, mis à part quelques
collines où ils ont construit leurs maisons. Aux alentours,
il y a d'autres îles plus ou moins grandes, certaines
habitées d'autres non. L'ensemble fait environ trois milles
de circonférence.
Durant notre séjour, nous
fûmes traités avec beaucoup d'humanité.
Nous mangeâmes leurs vivres pendant deux mois, sans nous
limiter : du beurre, du poisson et quelquefois de la viande.
Nous ne parvenions jamais à nous rassasier et si cette
nourriture n'avait pas eu des vertus laxatives, nous serions morts
d'avoir trop mangé. Notre médecine
était le lait fraîchement trait, car chaque chef
de famille avait quatre ou six petites vaches pour la subsistance des
siens.
☐
p. 38
|
|
Cristoforo Fioravante et Nicolò de
Michiel :
Ici, cent vingt pêcheurs habitent dans douze maisons ou
cabanes. Ils n'ont d'autre ressources que le poisson qu'ils
pêchent. (…) Ils échangent les fruits
de leur travail les uns contre les autres. Ils vendent des poissons
séchés au vent, que dans leur langue ils
appellent stock-fisch. Ils en apportent dans toute
la Dacia, la Suède et la Norvège, royaumes soumis
au roi de Dacia, où ils les troquent contre du cuir, des
tissus ou des vivres qui leur manquent. Mais entre eux, ils n'utilisent
aucune forme de monnaie battue.
(…)
Ici, l'avarice n'existe pas, et si parfois ils
ferment les portes ou pièces, c'est seulement par crainte
des bêtes sauvages ou des animaux domestiques.
Ici, la volonté des habitants est
tellement en accord avec celle de Dieu que lorsqu'un père,
un mari, un fils ou quelqu'un de cher vient à mourir, les
parents et les amis se réunissent pour prier son
âme et remercier Dieu. Ils ne ressentent ni ne manifestent
aucun sentiment de douleur et se retrouvent seulement pour louer le
Seigneur.
En vérité, nous pouvons dire
que du 3 février 1432 jusqu'au mois de mai 1432, nous avons
demeuré dans le premier cercle du paradis, loin de la
confusion et de l'opprobre des mœurs italiennes.
Ici, lorsque vient l'été,
les femmes se rendent dans des espèces de bains. Elles
sortent de leur maison aussi nues qu'à leur naissance, sans
vêtement, avec un faisceau d'herbes dans les mains, plus par
usage que par pudeur, car elles vivent purement et simplement. Vu la
fréquence de cette pratique, nous n'y faisions
même plus attention.
Ici, du 20 novembre au 20 février, la
nuit et l'obscurité se prolongent pendant vingt et une
heures ou plus, la lune cependant ne disparaissant jamais.
Ici, du 20 mai au 20 août, on voit le
soleil en permanence ou au moins une partie de ses rayons.
(…)
Ici, on pêche des flétans
d'une taille admirable. Nous en vîmes certains de 6 pieds et
demi de long [2 mètres], 2 pieds de large, un pied de haut
et de plus de 250 livres [80 kg].
Ici, il y a des peaux d'ours d'environ 12 pieds de
long, et blanches comme la neige la plus pure, chose incroyable pour
qui n'y est pas habitué.
☐
pp. 73-75
|
|
|
| COMPLÉMENT
BIBLIOGRAPHIQUE |
- Pietro Querini, Cristoforo Fioravante et Nicoló de Michiel, « Naufragés »
trad. du vénitien et postfacé par Claire Judde de
Larivière, Toulouse : Anacharsis (Griffe/Famagouste), 2022
|
- « Pietro
Quirini gentilhuomo
venetiano, il quale per fortuna di mare fu portato settanta gradi sotto
la Tramontana », « Naufragio del
medesimo,
descritto in conformità per Christoforo Fiorauante,
& Gioan
di Michele » in Giovanni Battista Ramusio, Secondo
volume
delle Navigationi et
Viaggi, In Venetia : Nella stamperia de Giunti,
MDLXXIIII [1574]
- « Viaggio
del magnifico messer Piero Quirino
viniziano, nel quale, partito di Candia con malvagie per ponente l'anno
1431, incorre in uno orribile e spaventoso naufragio, del quale alla
fine con diversi accidenti campato, arriva nella Norvegia e Svezia,
regni settentrionali », in Giovan Battista Ramusio, Delle navigationi
et viaggi (vol. IV), Torino : Einaudi,
1983
- Pietro
Querini, Cristoforo Fioravante et Nicoló de Michiel,
« Il naufragio della Querina : Veneziani
nel circolo
polare artico » a cura di Paolo Nelli,
Roma :
Nutrimenti (Transiti blu, 6), 2007
|
- Benjamin
Guérif, « Pietro Querini : les
naufragés
de Röst », Paris : Rivages, 2007
- Franco
Giliberto e Giuliano Piovan, « Alla larga da
Venezia :
l'incredibile viaggio di Pietro Querini oltre il circolo polare artico
nel '400 », Venezia : Marsilio (Le Maschere), 2008
- Paolo
Cossi (texte et dessins), « 1432 : le
Vénitien qui découvrit la
baccalà », Bruxelles : Dargaud,
2010
|
|
|
| mise-à-jour
: 6 mai 2022 |
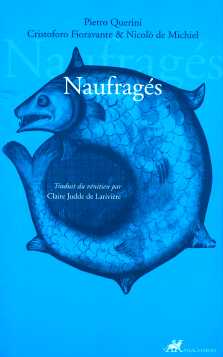
|
|
|
|