|
Gauguin, le dandy sauvage /
Olivier Apert. - Gollion : Infolio, 2012. -
175 p. ; 18 cm. - (Illlico).
ISBN
978-2-88474-939-8
|
|
L'essai
d'Olivier Apert est découpé en quatre temps qui,
chacun, renvoient à une toile :
— 1. Manao
tupapau (l'esprit des morts veille),
— 2. Te
rerioa (le rêve),
— 3. Ea
aere ia oe (où vas-tu ?)
— 4. Parau
na te varua ino (paroles du diable).
L'objectif
est d'éclairer l'œuvre du peintre par
l'œuvre de l'écrivain
— correspondance, articles,
livres.
Le
premier temps s'ouvre avec le faire-part (23 août 1903)
où Daniel de Monfreid
annonçait au monde de l'art la triste nouvelle de
la mort du
peintre, survenue trois mois et quinze jours plus
tôt ; il
s'achève sur le rappel des deux ventes de liquidation
effectuées par l'Administration, l'une aux Marquises,
l'autre
à Tahiti — histoire de faire
“ sonner et
trébucher cette réalité là
[…] l'Autoportrait
près du Golgotha
(1896) que Segalen obtient pour 7 francs ne vaut ni un kilo de
tabac ni une bouteille d'absinthe (pleine) ni une dame-jeanne (vide) ni
trois chemises en coton mais exactement un lot de bouteilles
(vides) ” 1.
Pour élucider ce
scandale qui illustre crûment l'écart
irréductible entre l'artiste
et la société de son temps, Olivier Apert
interroge les écrits de Gauguin qui
“ donnent à comprendre, souvent
paraboliquement, les
préoccupations, les conceptions, les querelles, les combats
du
peintre avec et contre son époque ” 2.
Le parcours de Gauguin en
Bretagne, en Martinique puis dans le Pacifique, où
certains ont cru voir la quête d'un exotisme convenu et
d'autres
une fuite, trouve ici sens et cohérence :
“ ce
devenir-sauvage est la condition sine
qua non du devenir-peintre ” 3.
Mais les obstacles ne manquent pas, dans la
société, dans
le milieu artistique, et dans la personnalité même
du
peintre en proie, comme Olivier Apert le relève à
juste
titre au “ fantasme … de faire
fortune ou du
moins de mener une vie facile ”
4.
Hiva Oa, terme du parcours
— “ au bout du bout du monde,
l'accalmie tant priée ? ”
5.
Volonté toujours tendue ; apaisement toujours
espéré. Gauguin ” peint avec
une ferveur
renouvelée plus d'une quarantaine de
tableaux ” 6.
L'essai se referme sur une évocation des Cavaliers sur la plage.
| ❙ | Olivier
Apert est poète, essayiste, librettiste, dramaturge et
traducteur. “ Comme tout le monde, certains lieux
m’ont marqué : (…) l’arc atlantique (Irlande,
Bretagne, Portugal) (…) et par-dessus tout, respiration intime,
la mer la mer (normande ou bretonne) quand les mouettes impassibles me
donnent leçon de stoïcisme ”. — Maison des écrivains et de la littérature [en ligne] | | |
| 1. |
pp. 27-28 |
| 2. |
p. 33 |
| 3. |
p. 107 (lire la phrase dans son contexte
ci-dessous) |
| 4. |
p. 108 |
| 5. |
p. 168 |
| 6. |
p. 168 |
|
| EXTRAIT |
À
Pont-Aven, une vive amitié s'est scellée entre
Gauguin et
Charles Laval (1862-1892), jeune peintre,
ex-élève de
Bonnat, de santé médiocre : c'est avec
lui qu'il
embarquera, dès avril 1887, de Saint-Nazaire pour le Panama
et
la Martinique. Rentré à Paris en novembre 1886,
Gauguin y
retrouve une certaine misère qu'il abhorre, un certain
anonymat
dans le milieu artistique qui l'insupporte de plus en plus :
« Demande à Schuffenecker ce que pensent
les peintres
de ma peinture, et cependant rien »
écrit-il à Mette le 26 décembre. Paris
est en
train de devenir métonymie d'une civilisation indigne, d'une
civilisation occidentale, qu'il faut fuir :
« Fuir ! là-bas
fuir », comme
l'exalte Mallarmé. Fuir au plus loin de cette civilisation
qui
ne tolère pas les pauvres, voire les exècre. Il
l'affirme
une dernière fois à Mette juste avant son
départ : « Mais ce que je veux
avant tout c'est
fuir Paris qui est un désert pour l'homme
pauvre ».
Et puis il ne saurait vivre sans projection, sans projets :
son
devenir-sauvage s'est, à l'intérieur de
lui-même,
consciemment formulé, métamorphosé en
volonté vécue comme une destinée
d'autant que ce
devenir-sauvage est la condition sine qua non du
devenir-peintre, son équivalent lucide dans la vie. Dans la
même lettre :
« Et
je m'en vais à Panama pour vivre en sauvage. Je connais
à
une lieue en mer de Panama une petite île (Taboga) dans le
Pacifique, elle est presque inhabitée, libre et fertile.
J'emporte mes couleurs et mes pinceaux et je me retremperai loin de
tous les hommes ».
Ces
accès d'apparentes misanthropie font
impérieusement
songer à Baudelaire qui déjà
prophétisait : « Peuples
civilisés, qui
parlez toujours sottement de sauvages
et de barbares,
bientôt,
comme dit d'Aurevilly, vous ne vaudrez même
plus assez pour être idolâtres » :
c'est exactement ce que Gauguin éprouve dans son sang
même
— Paris, c'est-à-dire la civilisation, ce
grand
désert d'homme conduit à une lente mais fatale
dilution
de l'énergie primitive (dans la lettre à
Mette :
« ce qui détruit non seulement ma
santé mais
mon énergie »).
Fuir la civilisation, c'est alors renouer avec l'instinct vital,
« se retremper », retrouver
l'énergie
primitive « pour être
idolâtre ».
☐ pp. 107-108 |
|
| COMPLÉMENT
BIBLIOGRAPHIQUE |
- Olivier Apert, « Irlande », Paris : Olivier Orban, 1992
- Tahar Bekri, « Marcher sur l'oubli » entretiens avec Olivier Apert, Paris : L'Harmattan, 2000
|
|
|
| mise-à-jour : 27 juillet 2021 |
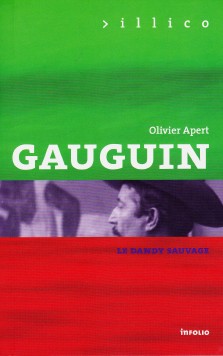 |
|
|
|