|
Namasté / Marcel
Cabon. - Rose Hill : Ed. de l'Océan Indien, 1981. -
XII-83 p.-[8] f. d'ill. ; 20 cm.
ISBN 978-99903-0-116-8
|
|
GÉRARD
FANCHIN : Ce roman
évoque l'histoire d'un jeune paysan hindou, Ram, qui
ayant hérité de son oncle Shive une
portion de terre […] entend la travailler, la faire
fructifier au prix de mille sacrifices et d'une vie
ascétique. C'est ainsi qu'est introduit le
thème du travail de la
terre ou celui du bonheur agreste. Ram,
à l'inverse de ses
confrères exploités qui triment dans
« l'enfer de la canne »
des propriétés sucrières, est
un petit propriétaire terrien (un petit
planteur dirait-on aujourd'hui), qui fait un travail librement
consenti. Du coup sont introduits le thème de la terre-salut
(opposé
à la terre-malédiction) et le
concept d'une politique agricole : « la
terre à celui qui la
travaille ».
Cet amour de
Ram pour la terre se confond avec l'amour d'une femme,
Oumaouti, sa compagne fidèle. Cette vision
idyllique de la paysannerie mauricienne comporte cependant des
zones d'ombre. Ram […] mène un combat
épique contre une terre rebelle
(rêche), des aléas climatiques
défavorables, l'hostilité du voisinage,
mais ce Namasté, ce bonjour
qu'il adresse quotidiennement
à son pire ennemi, finit par
faire taire les rancoeurs, la haine, et fait
naître l'entraide, la solidarité.
[…]
S'inscrivant dans la
lignée des grands romans paysans
tiermondistes :
« Diab-là » (1945)
de l'Antillais Zobel, et surtout, de « Gouverneur
de la rosée »
du Haïtien Jacques Roumain,
« Namasté » est un des
premiers romans à cerner la sensibilité
du paysan mauricien.
☐
Notre librairie, 114,
juillet-septembre 1993 — “ Littérature
Mauricienne ”
|
|
JEAN-LOUIS
JOUBERT :
La personnalité rayonnante de Marcel Cabon (1912-1972)
pourrait symboliser le passage du francotropisme flamboyant
à la pluralité culturelle assumée.
Marcel Cabon n'a jamais renié son admiration
passionnée de la littérature française
(en particulier son goût pour la grâce
d'écriture de Francis Jammes ou Alain-Fournier). Mais
pendant quarante ans, de ses débuts littéraires
en 1931 jusqu'à sa mort, il a été
comme le pivot de la littérature mauricienne,
généreux et toujours prêt à
épauler un confrère débutant, attentif
à toutes les idées, et surtout
défricheur infatigable d'une identité culturelle
mauricienne, qu'il baptisait mauricianisme et dont il proclamait la
richesse, née de la rencontre sur la même
île des cultures les plus diverses.
[…]
L'importance de Namasté
tient […] à ce que la publication du roman marque
une date dans l'histoire des relations entre la communauté
« créole » et la
communauté indienne de Maurice. Il s'agit en fait d'un acte
de « reconnaissance ».
Jusqu'alors, les indiens romanesques (chez Charoux ou Arthur Martial)
étaient peints par les romanciers mauriciens d'un point de
vue dépréciateur, voire offensant (il faudrait
mettre à part L'Étoile et la clef,
de Loys Masson, mais le roman est écrit et publié
en France). Dans Namasté, Marcel Cabon,
Mauricien créole, exprime le mouvement de sympathie qui le
porte à tenter de comprendre, de l'intérieur,
l'univers mental des Indo-Mauriciens. Il ne les rejette pas dans
l'extériorité du pittoresque, mais il sait faire
partager leur soif de terre et d'enracinement, en même temps
que leur nostalgie du pays perdu (l'école fondée
par Ram sert surtout à raconter aux enfants les belles
histoires tirées des grandes épopées
indiennes). Cette plongée à
l'intérieur du groupe indien de Maurice se fait dans une
langue émaillée de traits créoles, de
parlures indiennes, qui font partie du langage commun à tous
les Mauriciens. Façon de tisser, dans la trame plurielle du
texte, l'unité culturelle mauricienne que Cabon appelait de
ses vœux.
☐
« Littératures de
l'océan Indien »,
Vanves : Agence universitaire de la francophonie - EDICEF,
1991 (Ch. 10 — Modernités
mauriciennes : l'île plurielle)
|
| EXTRAIT |
Et tel était leur amour de la terre
qu'une grande joie leur gonflait le cœur quand les cannes
étaient mûres et que cent mille panaches
fleurissaient la plaine, comme l'armée d'un maharajah.
Ces cannes fleurissaient parce qu'ils avaient
défriché, pioché, sarclé,
dépaillé — comme l'esclave, jadis
—, parce qu'ils avaient donné leur sueur
à cette terre qui n'était pas à eux,
dont pas une parcelle ne serait peut-être à eux,
malgré les rigueurs auxquelles ils s'astreignaient,
malgré ces travaux de chaque heure et ce riz qu'ils se
refusaient pour que le fils eût une case à
lui …
Oui, combien de ces hommes n'avaient eu de terre
(eux qui aimaient tant la terre !) que la fosse où
on les avait couchés dans le langouti de tous les
jours !
Mais y songeant et malgré la peine qui
lui brûlait le cœur de tous ses souvenirs, Ram se
disait que si chacun le voulait, une grande joie viendrait à
tous les enfants de l'île d'aller ensemble sur les routes, de
quelque sang qu'ils soient …
Les mauvais souvenirs, alors, ne seraient plus
peut-être qu'un peu de poussière sous le
pied …
☐ Deuxième
partie, 4
|
|
| COMPLÉMENT
BIBLIOGRAPHIQUE |
- « Namasté »,
Port Louis (Maurice) : Le Cabestan (The Royal Printing), 1965
- « Namasté »,
in Océan
Indien éd. par Serge Meitinger et J.-C.
Carpanin Marimoutou, Paris : Omnibus, 1998
|
- « Diptyque »,
Port Louis (Maurice) : General printing and stationery Co.,
1935
- « Kélibé-Kéliba »,
Port Louis (Maurice) : Saint Louis (Maurice) : Ed.
Sammer, 1956 ; Port Louis (Maurice) : Croix du Sud,
s.d.
- « Rémy
Ollier », Port Louis (Maurice) : Ed.
Mauriciennes, 1964
- « Laurent
Rivet », Port Louis (Maurice) : Ed.
Mauriciennes, 1966
- « Le
rendez-vous de Lucknow », Port Louis
(Maurice) : The Mauritius printing Cy, 1966
- « Beau-Bassin,
petite ville », Port Louis (Maurice) : Club
mauricien du livre français, 1971
- « Michel
Darmon, poste restante », Port Louis
(Maurice) : Club mauricien du livre français, 1971
- « Brasse
au vent », Rose Hill (Maurice) : Ed. de
l'océan Indien, 1989
- « Contes,
nouvelles et chroniques » éd. par Aslakha
Callikan-Proag, Rose Hill (Maurice) : Ed. de
l'océan Indien, 1995
|
|
|
| mise-à-jour : 16
février 2006 |
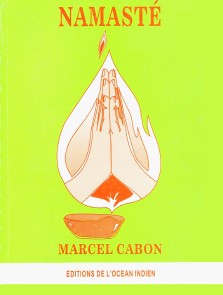 |
|
|
|