|
Les
mille automnes de Jacob de Zoet / David Mitchell ; traduit de
l'anglais par Manuel Berri. - Paris : L'Olivier, 2012. -
701 p. : ill. ; 22 cm.
ISBN
978-2-87929-761-3
|
|
Et
par-delà la porte-de-terre, songe
Jacob, s'étend
l'empire cloîtré.
☐ p. 42 |
Petit port de pêche au creux d'une baie
à l'ouest de
l'île de Kyūshū, Nagasaki commence à se
développer
dans la seconde moitié du XVIe
siècle avec l'arrivée de missionnaires
(François
Xavier) et de commerçants portugais. Très vite
perçue comme une menace, l'ouverture est alors
contrôlée, puis réprimée
avec une
brutalité croissante. Un siècle plus tard, les
Néerlandais négocient un accord avec le pouvoir
exercé localement par le clan Tokugawa pour y
établir une
présence exclusivement commerciale, proscrivant avec rigueur
tout prosélytisme chrétien. En 1641, la Compagnie
des
Indes Orientales — V.O.C. — est
autorisée
à s'implanter sur l'île artificielle de Dejima
(出島) dans
le port de Nagasaki où elle dispose d'entrepôts,
de
bureaux et de locaux fonctionnels. Après la faillite de la
Compagnie en 1798, la présence néerlandaise
à
Dejima s'est maintenue jusqu'en 1857.
Les
mille automne de Jacob de Zoet
s'inscrit dans les grandes lignes de cette histoire en se concentrant
sur les années 1799 et 1800. Les protagonistes et les
péripéties qu'ils affrontent éclairent
le dialogue
qui cherche à s'établir entre deux mondes.
Côté japonais, les premiers rôles sont
occupés par des interprètes dont la mission
première est de rendre accessibles aux élites
dirigeantes
ce qu'ils pensent être le meilleur des connaissances de
l'Occident — à l'image de la traduction
du
traité d'Adam Smith The
wealth of nations, objet
de bien des convoitises ; sur l'autre bord, Jacob de Zoet se
risque, en violation de consignes impératives, à
forcer
l'obstacle de la langue de ses interlocuteurs. Plus grave, il
s'éprend d'une jeune japonaise — Aibagawa
Orito — qui est autorisée à se
rendre à
Dejima pour y enrichir ses connaissances médicales
auprès
du docteur Marinus, habile praticien, lecteur de Diderot et
féru
de botanique.
Le romanesque a donc sa part dans ce
récit — pendant que les acteurs
du commerce et
du pouvoir intriguent pour faire prévaloir leurs
intérêts les plus sordides quelques
hommes et une
femme tentent, parfois maladroitement, de frayer la voie menant
à d'incertaines mais prometteuses rencontres. Comme sur une
scène de théâtre, les deux trames se
mêlent
à Dejima, île vouée aux
échanges ; mais “ … les
rendez-vous clandestins, et encore moins les romances clandestines,
sont choses impossibles en ces lieux ”
(p. 91).
| ❙ |
David
Mitchell est né en 1969 à Southport, dans le
Lancashire.
Il a vécu plusieurs années au Japon et a
enseigné
l'anglais à Hiroshima. Pour le New Yorker,
qui le compare à Vladimir Nabokov et à
José
Saramago, David Mitchell est “ l'un des rares
écrivains dont le don pour l'artifice est proprement
surnaturel ”. |
|
| EXTRAIT |
« J'en conclus »
— Yoshida
Hayato, l'auteur encore vaillant d'une savante monographie portant sur
l'âge véritable de la Terre, scrute son auditoire
constitué de quatre-vingt voire quatre-vingt-dix
érudits — « que cette
croyance
communément répandue selon laquelle le Japon est
une
imprenable forteresse n'est qu'une dangereuse illusion. Honorables
académiciens, notre pays n'est plus qu'un corps de ferme
délabré dont les murs s'effritent et le toit
s'écroule, et que ses voisins
convoitent. » Une
maladie des os ronge Yoshida : projeter sa voix dans l'immense
Salle aux soixante tatami est
épuisant. « Au nord-ouest de notre pays,
à une
demi-journée de traversée depuis l'île
de Tsushima,
vit l'orgueilleux peuple de Corée. Qui pourra oublier les
provocations inscrites sur les étendards que leur
dernière délégation
exhibait ?
" Inspectorat des dominions " et " Nous
sommes la
pureté ", ce qui, évidemment, implique "
Et pas
vous " ! »
Plusieurs
érudits manifestent leur accord en maugréant.
« Au
nord-est s'étend le vaste domaine d'Ezo, pays des farouches
Aïnu et de ces Russes qui ont cartographié nos
côtes
et prétendent que Karafuto leur appartient. Sakhaline,
nomment-ils-cette île. Voilà
déjà douze ans
qu'un Français, un
certain … »
— les lèvres de Yoshida
s'apprêtent à
prononcer le patronyme —
« … La
Pérouse, a baptisé de son nom le
détroit qui
sépare Ezo de Karafuto ! Les Français
toléreraient-ils l'existence d'un détroit Yoshida
au
large de leurs côtes ? »
L'argument, qui fait
mouche, est salué. « Les récentes
incursions
menées par les capitaines Benyowsky et Laxman sont
annonciatrices d'un avenir proche dans lequel les Européens
en
errance ne se contenteront plus de réclamer des vivres, mais
demanderont à établir des comptoirs commerciaux,
des
quais de débarquement, des réserves, des
fortifications
pour leurs ports, des traités inégaux. Les
colonies
pousseront comme du chiendent. Seulement alors comprendrons-nous que
notre imprenable forteresse n'était qu'une vue de l'esprit
et
que nos mers ne sont pas les " infranchissables
douves " que
l'on croyait, mais plutôt, comme l'écrivait mon
collègue visionnaire Hayashi Shihei, " une route
océane dépourvue de frontières qui
relie la Chine,
la Hollande et le pont Nihonbashi d'Edo ". »
☐ pp. 301-302 |
|
| COMPLÉMENT
BIBLIOGRAPHIQUE |
- « The
thousand autumns of Jacob de Zoet »,
London : Sceptre, 2010
- « Les
mille automnes de Jacob de Zoet », Paris :
Points (P2948), 2013
|
|
|
| mise-à-jour : 23
janvier 2019 |
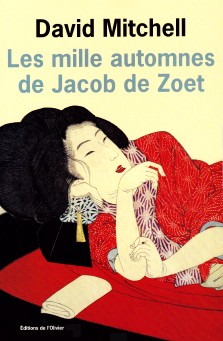
|
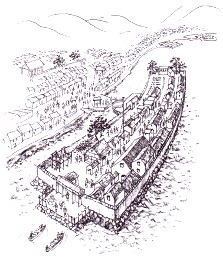
|
Dejima (p. 30)
|
|
|
|
|