|
Et si
on arrêtait de faire semblant ? / Jonathan
Franzen ;
trad. de l'anglais (Etats-Unis) par Olivier Deparis. - Paris :
L'Olivier, 2020. - 348 p. ; 22 cm.
ISBN
978-2-8236-0012-4
|
Les
textes réunis dans cet ouvrage datent pour le plus ancien de
2001 et, pour le plus récent, de 2019. Ces essais, articles
ou
conférences expriment la sensibilité
environnementale
d'un citoyen des Etats-Unis d'Amérique, ses interrogations
sur
le réchauffement climatique — causes et
conséquences —, et sur la
responsabilité de
l'homme dans le déclin des règnes animal et
végétal.
L'auteur s'est découvert une
attirance particulière pour le monde des oiseaux ;
il se
présente, non sans ironie, en disciple de saint
François
d'Assise. Plus militant qu'ornithologue, il court le monde pour un
état des lieux ; c'est ainsi qu'il
décrit la
situation critique du bassin méditerranéen
où,
sous couvert de traditions ancestrales, se perpétue un
gigantesque massacre d'espèces migratrices : en
Egypte, en
Albanie, en Italie mais également à Chypre ou
à
Malte — la seule note optimiste concerne la Sicile
où
Jonathan Franzen relève l'action tenace d'une
“ croisée célèbre,
Anna
Giordano ” grâce à qui
l'île
“ demeure pour ainsi dire libre de tout
braconnage ”.
L'enquête se poursuit jusqu'aux
confins de l'Antarctique où le fardeau de la
présence
humaine est plus léger : en Géorgie du
Sud ou aux
Shetland du Sud le bilan semble moins désespérant
qu'en
Europe ou en Chine, au prix souvent de campagnes
d'éradication
de prédateurs presque aussi dangereux que l'homme (chats,
rats
ou … souris) — mais
l'espoir est
fragile : “ les oiseaux marins nichent sur
des
îles lointaines et peu accueillantes, et passent l'essentiel
de
leur vie dans des eaux qui nous sont inhospitalières. S'ils
disparaissent totalement, qui le
remarquera ? ”
Ailleurs la réflexion environnementaliste croise
opportunément le souvenir de Robinson Crusoe
près du lieu où Alexander Selkirk, son
modèle
présumé, a été
abandonné à
lui-même. Jonathan Franzen a passé quelques jours
sur
l'île de Masafuera dans l'espoir d'apercevoir
“ l'un
des oiseaux chanteurs les plus rares du monde, le Synallaxe de
Masafuera ”. Rencontre impossible ! Mais
à
l'évocation du personnage créé par
Daniel Defoe
s'ouvrent de nouveaux champs de réflexion, de nouvelles
interrogations : Defoe “ nous a
donné le premier
portrait réaliste de l'individu radicalement
isolé, et
ensuite, comme poussé par une vérité
romanesque,
il nous a montré combien l'individualisme radical est en
réalité malsain et
insensé ”.
| ❙ |
Né
en 1959, Jonathan Franzen a passé son enfance dans
une
banlieue de Saint Louis (Missouri). Après des
études en
Pennsylvanie et à Berlin, il a travaillé comme
assistant
chercheur en géologie au Laboratoire de sismologie de
l'Université d'Harvard. Il est l'auteur de romans et
d'essais
traduits dans de nombreux pays et a reçu de prestigieux prix
littéraires dans son pays. |
|
FLORENT
GEORGESCO : […]
La lecture de Robinson
en pleine robinsonade promettait d’être savoureuse,
mais
pourquoi quitter Manhattan si c’est pour enfiler des
généralités sur
“ notre île
existentielle à nous ”
[…] ? Pourquoi
consacrer tant de pages à avertir, avec force raisons, bien
entendu, contre la destruction des oiseaux, mais ne jamais les regarder
vivre, bouger, s’individualiser, comme si eux aussi
étaient des
généralités ?
[…]
☐ Le Monde, 6
septembre 2020 [en
ligne]
|
PHILIPPE
LANÇON :
L’île Robinson Crusoe se trouve dans le Pacifique
Sud,
à 600 km des côtes chiliennes. On
l’appelle
aussi Más a Tierra (“ plus
près de la
terre ”). Il en existe une autre, 180 km
à
l’ouest, d’un relief plus escarpé,
d’un climat
plus hostile et où quasiment nul ne vit, qu’on
appelle
Más Afuera (“ plus
éloignée ”). On l’a
également
baptisée Alexander Selkirk, du nom du marin
écossais dont
la vie servit de modèle à Daniel Defoe pour
imaginer le
personnage de Robinson. Selkirk vécut de 1704 à
1709,
dans une complète solitude, non pas sur
l’île qui
porte aujourd’hui son nom, mais sur celle, plus vivable, qui
porte le nom du personnage de fiction qu’il inspira.
Ce
détail semble là pour rappeler que les liens
entre
réalité et fiction ne sont jamais simples ni
étanches. Ils sont d’autant plus attirants et
inquiétants qu’ils se développent,
comme Alexander
Selkirk sur son île, comme Robinson Crusoé sur la
sienne,
dans le plus grand isolement. Jonathan Franzen les explore
dans L’île
de la solitude,
récit autobiographique de 35 pages qui,
à lui seul,
console de l’angoisse et de la solitude dans lesquelles il
nous
est plus que jamais donné de vivre.
[…]
☐ Charlie Hebdo, 1474,
21 octobre 2020 [en
ligne]
|
| EXTRAIT |
Exactement à la moitié de Robinson Crusoé, alors
que Robinson est seul depuis quinze ans, il découvre une
empreinte de pied humain sur la plage et devient
littéralement
fou de peur. Arrivé à la conclusion que cette
empreinte
n'est ni la sienne ni celle du Diable, mais plutôt celle d'un
intrus cannibale, il transforme son île-jardin en forteresse,
et
pendant plusieurs années il ne pense guère
qu'à se
cacher et à repousser des envahisseurs imaginaires. Il
s'étonne de l'ironie de la situation :
Moi,
dont la seule affliction était de me voir banni de la
société humaine, seul, entouré par le
vaste
Océan, retranché de l'humanité et
condamné
à ce que j'appelais une vie silencieuse ;
[…] moi,
dis-je, je tremblais à la seule idée de voir un
homme, et
j'étais près de m'enfoncer sous terre
à cette
ombre, à cette apparence muette qu'un homme avait mis le
pied
dans l'île !
La psychologie
de Defoe n'a été nulle part plus aigüe
que dans son
imagination de la réaction de Robinson à la
rupture de sa
solitude.
☐ p. 54 |
|
| COMPLÉMENT
BIBLIOGRAPHIQUE |
- « Farther
away », New York : Farrar, Straus and
Giroux, 2012
- « The
end of the end of the earth », New York :
Farrar, Straus and Giroux, 2018
- « What
if we stopped pretending ? », The New Yorker, September
8, 2019
|
|
|
| mise-à-jour : 13
novembre 2020 |
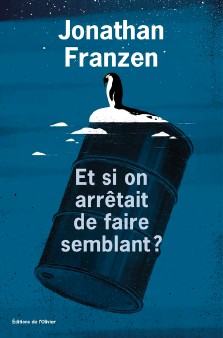 |
|
|
|