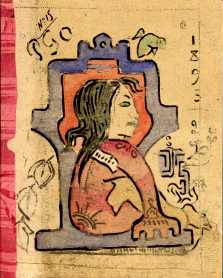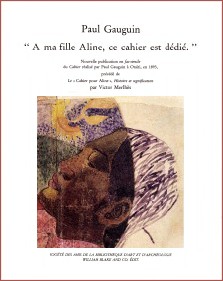|
A ma fille Aline, ce cahier
est dédié [nlle publication en fac-simile
du Cahier réalisé par Paul
Gauguin à Otaïti, en 1893,
précédé de Le « Cahier pour
Aline », Histoire et
signification par Victor Merlhès] / Paul Gauguin ;
éd. par Victor Merlhès. - Paris :
Sté des Amis de la Bibliothèque d'Art et
d'Archéologie, Bordeaux : William Blake & Co., 1989. - (2 vol.) 86 p.-[56] p. de pl. :
ill. ; 23 cm.
ISBN 2-905810-32-7
|
Quand
il débarque à Tahiti pour la
première fois, en juin 1891, Gauguin cherche un monde
nouveau, mais il n'a pas renoncé à tout ce qui
l'attache durablement à l'Europe.
Dès les mois qui suivent, il éprouve une
première désillusion au spectacle du monde
polynésien qu'il voit reculer et vaciller face aux
assauts du colonialisme. Dans le même
temps il souffre chaque jour plus âprement du
déracinement qu'il s'est imposé.
Le Cahier pour Aline
peut être lu comme le journal d'un exilé. A
l'exception des quelques paragraphes consacrés
à la genèse du tableau Manao
Tupapau, l'île où Gauguin
réside pourtant depuis presque deux ans est absente du texte
rédigé en 1893. Au contraire, tout
y désigne les antipodes :
références à Edgar Poe, Wagner,
Schumann, Rembrandt, Corot, Verlaine,
Balzac, … Colère à
l'évocation du petit [Emile] Bernard. Et, surtout, la
dédicace appuyée à ma fille
Aline.
En opposition remarquable avec
le texte, plus connu, de Noa Noa,
le Cahier impose donc une
image par défaut de
l'île, lieu d'un manque — éprouvé douloureusement envers sa fille Aline. Seule la présentation
matérielle du cahier d'écolier
où s'exprime si directement cet amour paternel évoque Tahiti : la couverture d'origine est recouverte de tapa 1 et ornée d'un
dessin aquarellé représentant un tupapau,
figure errante qui hante les nuits des îles.
Les idées
consignées sur le Cahier ne cesseront jamais leur travail dans l'esprit de Gauguin ; beaucoup
reparaîtront dans les écrits
postérieurs : dans les Notes sur l'art
à l'Exposition universelle (1889), dans le
manuscrit (toujours inédit) Diverses
choses (1896-1897), dans Avant et après
(1902).
En 1897, apprenant la mort
d'Aline qui venait d'avoir dix-neuf ans, Gauguin est violemment
ébranlé : “ Sa tombe
là-bas, des fleurs — apparence que tout
celà. Sa tombe est ici tout près de moi.
Mes larmes sont les fleurs ; vivantes
celles-là » 2.
Le Cahier l'accompagnera jusqu'à sa
propre fin, quatre ans plus tard ; Segalen pourra le consulter aux
Marquises, parmi les autres vestiges consignés par
l'administration.
| 1. | nom
donné par les Polynésiens à une
étoffe
réalisée à partir d'écorce
d'arbre. | | 2. | lettre inédite à Mette,
citée dans le commentaire de Victor Merlhès. |
|
|
VICTOR
MERLHÈS
: Tahiti ! Sur la foi d'un mot de
Mirbeau : « Tahiti —
entrevu jadis pendant ses voyages de marin »,
on a prétendu que Gauguin y aurait fait escale en 1867. Rien
n'est moins sûr. Quoi qu'il en soit, il s'informe et
s'enthousiasme : « J'ai lu un
livre du département des colonies donnant bien des
renseignements sur l'existence de Taïti,
écrit-il au mois d'août [1890] à son
camarade Schuffenecker. Merveilleux pays dans lequel je
voudrais y terminer mon existence avec tous mes enfants. Je
verrais plus tard à les faire venir —
(…) Je ne vis plus ici que dans cette espérance
de la terre promise ».
☐
Vol. 2, p. 19
|
| COMPLÉMENT
BIBLIOGRAPHIQUE |
- Le
manuscrit conservé au Fonds Jacques Doucet de la
Bibliothèque d'Art et d'Archéologie, a fait
l'objet d'une première édition en fac-simile (500
exemplaires), avec un commentaire de Suzanne Damiron, en 1963.
- Présentation
richement illustrée du manuscrit consultable sur le site de
l'Institut
National d'Histoire de l'Art (INHA).
|
- « Cahier
pour Aline » préface de Philippe Dagen,
Paris :
Ed. du Sonneur (La Petite bibliothèque), 2009
- «
À ma fille Aline, ce cahier est dédié »
relevé des inscriptions portées par l'artiste sur le
cahier manuscrit confectionné pour sa fille Aline à
Otaïti en 1891, Bordeaux : William Blake & Co., 2015
|
|