|
The artist and the
camera : Degas to Picasso [exhibition : San Francisco
museum of modern art, October 2, 1999-January 4, 2000 ; Dallas
museum of art : February 1-May 7, 2000 ; Bilbao,
Museo Guggenheim, June 12-September 10, 2000] / sous la dir. de Dorothy
Kosinski. - Dallas : Museum of modern art ; New
Haven : Yale university press, 1999. -
335 p. : ill. ; 31 cm.
ISBN 0-300-08168-5
|
|
A l'occasion d'une exposition
sur les relations entre peinture et photographie, Elizabeth Childs
interroge l'œuvre tahitienne de Gauguin dont on connait les “ emprunts ” avoués,
au photographe Charles Spitz parmi d'autres.
Dans le
droit fil de la
critique universitaire américaine, Elizabeth Childs
procède à un examen méthodique et
très minutieux des propos tenus par Gauguin
— où auraient pu s'exprimer les fondements
méthodiques et techniques de sa création — et,
surtout, des exemples où il utilise la
photographie comme support ou relai de son inspiration. On trouve donc
dans cette contribution, maillon d'une recherche de longue haleine, un
inventaire non dénué
d'intérêt.
Or la contribution d'Elizabeth
Childs ne se borne pas à un relevé des rencontres
entre Gauguin et la plaque sensible — la
connaissance de l'œuvre y aurait gagné. Comme le
titre le révèle non sans emphase, le propos est
d'associer l'irruption, fût-elle indirecte, de la technique
dans l'œuvre du peintre à un tournant historique
très connoté. Au passage d'un siècle
au suivant, on saute naturellement d'une « fin de
siècle » à un
« début de
siècle » ; Elizabeth Childs
ignore, ou feint d'ignorer, cette double et indissociable polarité du temps : elle inscrit
délibérément l'aventure artistique de
Gauguin dans le cadre du XIXe siècle finissant, en déclin, en décadence.
Dès lors,
l'identification et l'analyse des apports de la photographie
à la pratique du peintre sont mises à
contribution pour tenter d'accréditer l'hypothèse
d'un écart irréductible entre celui-ci et les
êtres et les lieux censés l'inspirer. Contre toute
vraisemblance, Gauguin est donc irrémédiablement ancré dans le
siècle finissant. Pour Elisabeth Childs qui met en scène un nouvel épisode de la querelle des anciens et des modernes, le peintre est relégué avec la vieille garde, tenant d'un exotisme
désuet voire agent passif du colonialisme français ; son apport au siècle qui
s'ouvre est occulté ; le sens de son engagement
artistique et personnel dénié, voire
inversé. On peut s'étonner du
déséquilibre entre la fragilité des arguments à charge d'une part, la portée
du jugement et du discrédit d'autre part.
|
| COMPLÉMENT
BIBLIOGRAPHIQUE |
- « The
colonial lens : Gauguin, primitivism, and photography in the
fin-de-siècle », in : Lynda
Jessup (ed.), Antimodernism and artistic
experience : policing the boundaries of modernity,
Toronto : University of Toronto press, 2001
- « Invitation
au paradis : Gauguin face à la
photographie », in : Riccardo Pineri
(éd.), Paul
Gauguin, héritage et confrontation,
Actes du colloque organisé par l'Université de la
Polynésie française es 6, 7 et 8 mars 2003,
Papeete : Le Motu, 2003
- « Edens's
other : Gauguin and the ethnographic
grotesque », in : Frances Connelly (ed.), Modern
art and the grotesque, Cambridge : Cambridge
university press, 2003
- « Exoticism
in the South Seas : John La Farge and Henry Adams encounter
the
Pacific », in Elisabeth Hodermarsky (dir.), John La Farge's second
paradise : voyages in the South Seas, 1890-1891,
New Haven : Yale university press, 2010
- « Common
ground : John La Farge and Paul Gauguin in
Tahiti », in Elisabeth Hodermarsky (dir.), John La Farge's second
paradise : voyages in the South Seas, 1890-1891, New
Haven : Yale university press, 2010
- « Remixing paradise : Gauguin and the Marquesas islands », in : Suzanne Greub (ed.), Gauguin Polynesia, München : Hirmer, 2011
- « Vanishing
paradise : art and exoticism in colonial
Tahiti »,
Berkeley : University of California press, 2013
- « Gauguin
and sculpture : the art of the
" ultra-sauvage " », in Starr
Figura (dir.), Gauguin :
metamorphoses, New York : Museum of modern art,
2014
- « Gauguin in Tahiti: encounters and inventions in the 1890s », in Christina Hellmic (dir.), Gauguin : a spiritual journey, New York : Prestel, 2018
|
|
|
| mise-à-jour : 3 août 2021 |
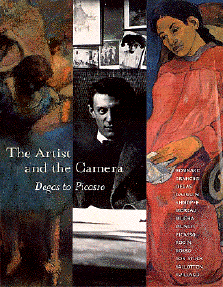
|
|
|
|