|
Langage
plastique et énonciation identitaire : l'invention
de l'art
haïtien / Carlo A. Célius. - Sainte Foy
(Québec) : Les Presses de l'université
Laval, 2007.
- XI-419 p. ; 23 cm. - (InterCultures).
ISBN
978-2-7637-8637-7
|
NOTE
DE L'ÉDITEUR
: L'histoire des beaux-arts en Haïti remonte
à la
période coloniale. Cependant c'est avec le mouvement
pictural
des années 1930 que commence à se poser la
question de
l'haïtianité en matière artistique,
laquelle
connaît une reformulation avec l'avènement de
l'art
naïf en 1945-1947. Et c'est autour de cette
problématique
que se constitue, pour la première fois dans l'histoire
intellectuelle du pays, un véritable espace discursif sur
les
arts plastiques.
Certes le
discours sur l'art n'était pas
totalement inexistant jusque-là, toutefois un espace
discursif
propre se dégage dans la première
moitié du XXe
siècle. En effet, un ensemble de problèmes surgit
dont le
traitement diversifié génère une masse
discursive
importante, clairement identifiable, traduisant des enjeux
spécifiques et ayant des effets repérables.
La
focalisation des débats sur l'art naïf a
engendré
deux grandes tendances. La première,
hégémonique,
soutient que seul ce type d'art exprime la véritable
authenticité haïtienne. La seconde, qui adopte une
démarche intégrative, non exclusiviste,
élabore
une version complexe de l'haïtianité en prenant en
considération toutes les propositions artistiques. Ainsi,
s'est
engagée, dans les limites d'un même paradigme, une
véritable « bataille de
discours » qui
réaffirme la dimension conflictuelle de
l'énonciation
identitaire.
| ❙ | Historien
et historien de l’art, Carlo A. Célius est chercheur
affilié au Centre interuniversitaire d’études sur
les lettres, les arts et les traditions (CELAT, Université
Laval, Québec). |
|
SOMMAIRE
(résumé) |
Remerciements
Introduction
- Chapitre
I : Protagonistes
et corpus 1
- Chapitre
II : « Modernité
indigène » et irrun de l'art naïf
- Chapitre
III : De
l'hégémonie de l'art naïf
- Chapitre
IV : Refus,
contestations et alternatives
- Chapitre
V : Limites du
discours institué et nouvelles considérations
Conclusions
Bibliographie (pp. 371-419)
| 1. |
«
Les
bibliographies d'Haïti ne laissent nullement supposer la
densité de la production discursive sur les langages
plastiques
du pays, de même que les rares tentatives d'interrogation
portant
sur l'existence de ce discours. En attendant, de la masse de
références que nous avons pu consulter, nous
avons
dégagé un corpus d'écrits qui nous ont
paru
essentiels (…). Les auteurs retenus sont :
Philippe
Thoby-Marcelin
(Haïti) ; José
Gómez Sicre
(Cuba) ; Albert
Mangonès
(Haïti) ; Dewitt
Peters
(États-Unis) ; Selden
Rodman
(États-Unis) ; Lucien
Price
(Haïti) ; Max
Pinchinat
(Haïti) ; Félix
Morisseau-Leroy
(Haïti) ; Jacques
Gabriel
(Haïti) ; Jacques
Stephen Alexis
(Haïti) ; Pierre
Mabille
(France) ; André
Breton
(France) ; Eleanor
Ingalls Christensen
(États-Unis) ; Ute
Stebich
(États-Unis) ; André
Malraux
(France) ; Jean-Marie
Drot
(France) ; Michel-Philippe
Lerebours
(Haïti). » (Ch. I,
pp. 17-18) |
|
|
| COMPLÉMENT
BIBLIOGRAPHIQUE |
|
|
- « Création
plastique d'Haïti » dossier
coordonné par Carlo
A. Célius, Paris : Musée du quai Branly
(Gradhiva,
21), 2015
- « Le
défi haïtien : économie,
dynamique
sociopolitique et migration » sous la dir. de Carlo
A.
Célius, Paris : L'Harmattan (Horizons Amériques latines), 2011
- « Haïti
face au passé / Haiti confronting the past »
sous la dir. de Carlo A. Célius, Ethnologies, Revue
de l'Association canadienne d'ethnologie et de folklore (Sainte Foy,
Québec), vol. 28, 1, 2006
- « La
création plastique et le tournant ethnologique en
Haïti », Gradhiva [en ligne],
1 | 2005
- « Cheminement
anthropologique en Haïti », Gradhiva [en ligne], 1
| 2005
|
- Gérald Alexis, « Peintres haïtiens », Paris : Cercle d'art, 2001
- Philippe Bécoulet, « La peinture haitienne : dialogue du réel et de l'imaginaire », Strasbourg : Association franco-haïtienne pour la promotion des arts et de la culture, 1990
- [Comité Hector Hyppolite], « Hector Hyppolite », Paris : Ed. de Capri, Musée du Louvre, 2011
- Jean-Marie Drot (éd.), « An encounter between two worlds, as seen by Haitian artists », Paris : Fondation Afrique en créations, Rome : Carte Segrete, v. 1992
- Michèle Grandjean, « Artistes en Haïti : cent parmi d'autres », Marseille : Association Art et cœur, 1997
- Ernst Jean-Pierre, « Le voyage d'un peintre haïtien en Bretagne », Rennes : Ouest France, 2005
- Jean-Robert Léonidas, « Rêver d'Haïti en couleurs = Colorful dreams of Haiti » photographies de Frantz Michaud, Montréal : CIDIHCA, 2009
- Michel-Philippe Lerebours, « Haïti et ses peintres de 1804 à 1980 : souffrances et espoirs d'un peuple », Port-au-Prince : Imprimeur II, 1989
- Martine Lusardy (dir.) « Haïti, anges et démons », Paris : Hoëbeke, 2000
- Selden Rodman, « Where art is joy : Haitian art, the first forty years », New York : Ruggles de Latour, 1988
|
|
|
| mise-à-jour : 29 juillet 2021 |
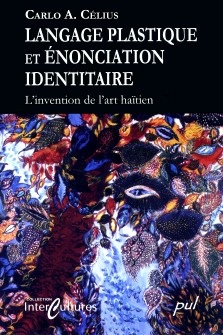
|
|
|
|