|
Ulysse / James
Joyce ; nlle édition sous la direction de Jacques
Aubert ; trad. de l'anglais (Irlande) par Stuart Gilbert,
Valery Larbaud, Auguste Morel, Jacques Aubert, Pascal Bataillard,
Michel Cusin, Sylvie Doizelet, Patrick Drevet, Bernard Hoepffner,
Tiphaine Samoyault et Marie-Danièle Vors. - Paris :
Gallimard, 2004. - 981 p. ; 21 cm. - (Du
monde entier).
ISBN 2-07-076349-8
|
|
Roman exceptionnel
à tous égards, Ulysse devait
nécessairement confronter ses traducteurs à
d'exceptionnelles difficultés. La première (et
longtemps unique) traduction française est l'œuvre
d'Auguste Morel assisté de Stuart Gilbert ; ce
travail a bénéficié, avant la
publication (1929) du concours notoire mais difficilement
évaluable de Valery Larbaud et de Joyce lui-même.
La nouvelle traduction
proposée en 2004 s'accompagne, ce qui n'est pas pour
surprendre, d'une tentative de justification dont on retiendra, parmi
d'autres, deux composantes.
“ Les raisons qui plaident en
faveur d'une nouvelle traduction sont nombreuses. D'une part elle
compense les défauts inhérents à une
traduction proche historiquement de l'original, proximité
qui empêche d'en saisir toute la complexité. Elle
propose une version plus proche à la fois du texte de James
Joyce et de nous.
[…]
« Joyce l'a répété,
il a écrit son livre de dix-huit points de vue qui sont
autant de styles différents. C'était favoriser
l'idée d'une traduction collective, dont l'avantage est
d'éviter que le recours à un seul traducteur, si
brillant fût-il, ne donne à la lecture de
l'œuvre un infléchissement trop personnel et que
le texte ne résonne d'une seule voix. ”
☐
Jacques Aubert et l'ensemble
des traducteurs, Postface
“ Écrire après
Joyce ”, pp. 972-975
De fait le
découpage du roman en dix-huit séquences, ou
épisodes, a sous-tendu la constitution d'un groupe de huit
traducteurs dont certains n'ont traduit qu'un épisode
(Michel Cusin pour l'épisode dit de Nestor,
Marie-Danièle Vors pour l'épisode de Calypso
et Sylvie Doizelet pour celui de Charybde et Scylla),
d'autres deux (Jacques Aubert pour les épisodes de Télémaque
et des Rochers errants, Patrick Drevet pour Hadès
et Nausicaa) ; Pascal Bataillard a traduit
trois épisodes (Protée, Les
Lotophages, Eumée), tout comme Bernard Hoepffner (Éole,
Circé, Ithaque), et Tiphaine
Samoyault en a traduit quatre (Les Lestrygons, Les
Sirènes, Le Cyclope, Pénélope).
Reste un épisode, l'un des plus délicats
à traiter quant à la forme, celui dit des Bœufs
du Soleil, pour lequel c'est le texte de la traduction
d'Auguste Morel qui a été repris.
Face
à cet
impressionnant concours de compétences, chaque lecteur
pourra s'interroger sur la pertinence de tel ou tel choix (il arrive
que les solutions retenues, parfois en rupture
délibérée avec la première
traduction, surprennent) ; on peut également tenter
d'évaluer la compatibilité entre les options propres
à tel
ou tel membre de l'équipe de traducteurs et le souci collectiff
de
“ coller ” étroitement
aux changements de points de vue souhaités par l'auteur.
Mais c'est sur le souffle qui, de l'ouverture au soliloque final, anime
le roman et lui donne sa cohérence que portera le jugement
le plus recevable.
Le premier mérite
de cette aventure peu commune est, pour l'heure, de fournir une
nouvelle occasion de plonger dans une œuvre qui est loin
d'avoir livré toutes ses richesses.
|
| JORGE LUIS BORGES |
Dans les
pages d'Ulysse bouillone
la réalité totale avec un vacarme de
manège ; non point la médiocre
réalité de ceux qui ne voient dans le monde que
les opérations abstraites de l'âme et la peur
ambitieuse de ne pas se superposer à la mort, ni cette autre
réalité approximative qui
pénètre nos sens et dans laquelle coexistent le
trottoir et notre chair, la citerne et la lune. En lui, se trouve la
dualité de l'existence, cette inquiétude
ontologique qui ne s'étonne pas seulement d'être,
mais d'être dans ce monde précis, fait de
corridors et de mots, de cartes à jouer et d'inscriptions
électriques dans la limpidité des nuits. Dans
aucun livre — à l'exception de ceux qu'a
écrits Ramón — nous ne trouvons le
témoignage de la présence effective des choses
avec une si convaincante fermeté. Ces choses, ici, sont
toutes latentes et la diction de chaque mot les fait surgir habilement
et nous déconcerte par son bref avènement.
☐
« L' Ulysse
de James Joyce »,
chronique publiée dans la revue
« Proa », in : Œuvres
complètes (tome 1,
pp. 872-873), Paris : Gallimard (La
Pléiade), 1993
|
| MICHEL BUTOR |
Dans une
journée de Dublin, il est possible de retrouver L'Odyssée tout
entière. Au milieu de l'étrangeté
contemporaine se réincarnent les anciens mythes et les
rapports qu'ils expriment restent universels et éternels.
C'est Stuart Gilbert, je pense, qui a le premier signalé
l'importance que prend le mot métempsychose dans le cours du
livre. Au moment du lever de son mari, Molly Bloom lui demande la
signification de ce mot qu'elle déforme. Et tout au long de
la journée, ce mot ou des mots associés
résonneront dans l'esprit du journaliste. A travers ce vieux
rêve du retour s'exprime le dur besoin de durer,
d'échapper à la fatale érosion du
temps. Il peut être considéré comme une
mauvaise interprétation de cette soif de structures
fondamentales organisant les âges et leurs
détours. « L'Histoire est un cauchemar
dont j'essaie de m'éveiller »,
déclare Stephen. Cela ne suffirait-il pas à nous
persuader qu'Ulysses a des
intentions magiques ou gnostiques ?
☐
« L'archipel
Joyce »,
in : Essais sur les modernes,
Paris : Gallimard (Idées, 61), 1964
(p. 260)
|
| VLADIMIR NABOKOV |
Quel est […] le thème
central [d'Ulysse] ? Il est très
simple :
1-
Le passé sans espoir : le fils
nouveau-né de Bloom est mort il y a longtemps, mais son
cerveau et son sang en gardent la vision.
2-
Le ridicule et tragique présent : Bloom aime
toujours sa femme Molly, mais il laisse le Destin agir à sa
guise. Il sait que dans l'après-midi, à quatre
heures et demie de cette journée de la mi-juin, Boylan, le
fougueux impresario, l'organisateur de concerts, rendra visite
à Molly, et Bloom ne fait rien pour l'empêcher. Il
tente sur la pointe des pieds de ne pas croiser le chemin du Destin,
mais tout au long de la journée il est continuellement sur
le point de tomber sur Boylan.
3-
Le pathétique futur : Bloom croise aussi le chemin
d'un autre jeune homme, Stephen Dedalus. Bloom prend peu à
peu conscience du fait qu'il faut peut-être voir
là une autre petite attention du Destin. Si la femme doit
avoir un amant, alors mieux vaudrait que ce soit le jeune homme
sensible, l'artiste qu'est Stephen plutôt que le vulgaire
Boylan. Stephen pourrait en effet donner des leçons
à Molly, l'aider à travailler sa prononciation
italienne, très utile dans la profession de chanteuse, bref
son influence pourrait affiner Molly, songe pathétiquement
Bloom.
Voilà
le thème central : Bloom et le Destin.
☐
« James Joyce
(1882-1941) :
Ulysse (1922) », in : Littératures I,
Paris : Livre de poche
(Biblio-Essais, 4065), 1987 (pp. 387-388)
|
| VIRGINIA WOOLF |
Je devrais
lire Ulysse
et en faire, pour moi, le procès, pour ou contre. Jusqu'ici
j'en
ai lu deux cents pages, pas tout à fait le tiers. J'ai
été amusée, stimulée,
séduite,
intéressées par les deux ou trois premiers
chapitres
jusqu'à la fin de la scène du
cimetière ;
puis embarrassée, assommée, irritée et
déçue par cet écœurant
étudiant qui
gratte ses boutons. Dire que Tom [T.S. Eliot], le grand Tom, trouve
qu'on peut comparer cela à Guerre et Paix !
☐ « Journal
d'un écrivain » — 16
août
1922 ; Paris : 10/18, 2000 (p. 85)
Ainsi
Joyce est mort. Joyce qui avait à peu près quinze
jours
de moins que moi. Je me souviens de Miss Weaver avec ses gants de
laine, déposant le manuscrit dactylographié
d’Ulysse sur
notre table à thé, à Hogarth House.
(…)
Allions-nous consacrer nos existences à
l’édition
de ce livre ? (…) Je le rangeai dans le tiroir du
secrétaire de marqueterie. Un jour Katherine Mansfield vint
me
voir et je le sortis. Elle commença à lire,
à se
moquer, puis déclara brusquement :
« Mais il y a
quelque chose là-dedans. » Une
scène,
j’imagine, qui devrait figurer dans l’histoire de
la
littérature. Il évoluait dans notre entourage
mais je ne
l’ai jamais rencontré. Et puis je me souviens de
Tom
(…) disant (le livre était
déjà
publié) : « Que peut-on
écrire,
après avoir réussi l’immense prodige de
ce dernier
chapitre ? » Il était pour la
première
fois, à ma connaissance, transporté,
enthousiaste.
J’achetai le livre recouvert de papier bleu et le lus ici un
été, je crois, avec des frissons
d’émerveillement, de découverte et de
nouveau avec
de longs intervalles de prodigieux ennui. Cela remonte à une
époque préhistorique. Et maintenant tous les
beaux
messieurs sont en train de fourbir à neuf leurs opinions, et
les
livres, je suppose, prennent leur rang dans la longue procession.
☐ «
Journal d'un écrivain » — 15
février 1941 ; Paris : 10/18, 2000 (pp. 569-570)
|
|
| COMPLÉMENT
BIBLIOGRAPHIQUE |
- « Ulysses »,
Paris : Shakespeare and Company, 1922
|
- « Ulysse »
trad. de l'anglais par Auguste Morel assisté par Stuart
Gilbert (trad. revue par Valery Larbaud avec la collaboration de
l'auteur), Paris : La Maison des amis du livre (Adrienne
Monnier), 1929
- « Ulysse » trad. de l'anglais par Auguste Morel
assisté par Stuart Gilbert (trad. revue par Valery Larbaud
avec la collaboration de l'auteur), in
Œuvres,
tome II, éd.
sous la dir. de Jacques Aubert,
Paris : Gallimard (La Pléiade), 1995
- « Ulysse »
trad. de l'anglais par Auguste Morel […], Paris :
Gallimard (Folio, 2830), 1996
|
- « Ulysse »
nouvelle éd. sous la dir. de Jacques Aubert,
Paris : Gallimard (Folio, 4457), 2006
- « Ulysse »
nouvelle éd. sous la dir. de Jacques Aubert, enrichie d'un Dossier (Chronologie,
Notice sur l'histoire du texte, Schémas explicatifs,
Bibliographie, Notices, Notes, Plans de Dublin, Index),
Paris :
Gallimard (Folio classique, 5641), 2013
|
- « Lettres à Nora »,
Paris : Payot & Rivages (Petite
bibliothèque, 741), 2012
|
- Homère
« Odyssée »,
Paris : Gallimard (Folio classique, 3235), 2003
|
- Frank Budgen,
« James Joyce et
la création d'Ulysse »,
Paris : Denoël, 2004
- Anthony Burgess,
« Au sujet de James Joyce »,
Paris : Le Serpent à plumes, 2008
- Don
Gifford, « Ulysses
annotated » revised and expanded ed.,
Berkeley : University of California press, 2008
- Adrien
Le Bihan, « Je naviguerai vers l'autel de
Joyce », Espelette : Cherche-bruit, 2010
- Adrien,
« James Joyce travesti par trois clercs
parisiens », Espelette : Cherche-bruit, 2011
- Julián
Ríos, « Chez
Ulysse », Auch : Tristram, 2007
- Italo
Svevo, « Ulysse
est né à Trieste », Bordeaux :
Finitude, 2004
- Enrique
Vila-Matas, « Dublinesca »,
Paris : Christian Bourgois, 2010
|
|
|
| mise-à-jour : 25 février 2021 |
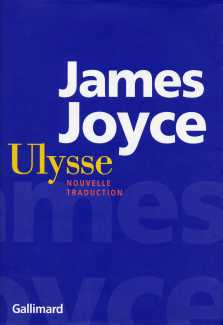
|
|
|
|