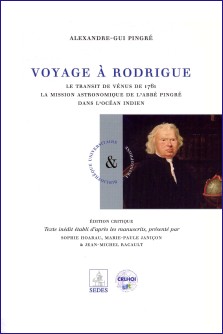|
Voyage à
Rodrigue, le transit de Vénus de 1761 : la mission
astronomique de l'abbé Pingré dans l'océan Indien
/ Alexandre-Gui Pingré ; édition critique
établie et présentée par Sophie Hoarau,
Marie-Paule Janiçon et Jean-Michel Racault. - Paris, Saint-Denis
(La Réunion) : Sedes, Université de La
Réunion, 2004. - 373 p. : ill., cartes ;
24 cm. - (Bibliothèque universitaire francophone).
ISBN 2-84784-122-9
|
Si
l'abbé Pingré s'était
borné, dans sa relation, au seul objectif officiel de sa
mission — l'observation astronomique du passage de
Vénus entre la terre et le soleil —, il trouverait
aujourd'hui peu de lecteurs ; mais il a consigné
sur son journal les principaux faits ayant retenu son attention sur
l'île Rodrigue, à l'île de France
(Maurice) et à l'île Bourbon (La
Réunion), ainsi que durant la navigation de Lorient (port
d'embarquement de la Compagnie des Indes) à Lisbonne (terme
de son voyage maritime d'où il regagne Paris par voie de
terre).Le
Voyage à Rodrigue porte
donc sur les trois îles de l'océan
Indien — géographie, climat,
faune, flore, … L'intérêt de
ce précieux témoignage tient pour une large part
à la vivacité du regard de l'auteur, à
ses qualités d'observation et d'analyse, à sa
maîtrise des principales disciplines scientifiques 1 de l'époque et,
surtout, à son inlassable curiosité. Les
historiens notent en outre que cette relation comble une lacune et
marque un utile jalon chronologique avant le séjour de Bernardin de Saint-Pierre
(1768-1770). On notera enfin que Pingré avait soigneusement
préparé son voyage et ne manque pas de renvoyer
aux écrits de certains de ses
prédécesseurs, François Leguat par
exemple.
| 1. | L'abbé
Pingré (1711-1796) l'un des grands spécialistes d'une
question cruciale en son temps, la détermination des longitudes
; durant le voyage aller il eut ainsi l'occasion de constater
l'inexactitude de la position des îles du Cap Vert sur les cartes
marines utilisées pour l'expédition : « Il fut
décidé unanimement que ces îles étaient
très mal placées sur la carte. Il ne faut cependant pas
en conclure que ce soit la faute du géographe qui a
dressé cette carte : il a pu manquer de mémoire. La seule
conséquence que je prétends tirer de notre accident, est
qu'il serait nécessaire de travailler à rectifier la
position de ces îles » (p. 61). |
|
|
INTRODUCTION :
[…]
Le récit de
Pingré est le résultat ou plutôt la
conséquence annexe de l'une de ces grandes
expéditions scientifiques caractéristiques de la
pensée du XVIIIe
siècle, période qui fut leur âge d'or.
L'ambition de tout connaître et de tout comprendre implique
que toutes choses soient préalablement
inventoriées, mesurées, décrites,
classées et nommées. Afin de réaliser
ce programme de totalisation du savoir, la science des
Lumières exige du savant, devenu voyageur, qu'il sorte du
cadre confiné de son cabinet ou de sa
bibliothèque pour parcourir concrètement l'espace
du globe. Sans exclure entièrement d'éventuelles
préoccupations commerciales, diplomatiques, voire
militaires, les grandes expéditions de circumnavigation de
la fin du siècle poursuivent un but au sens propre du terme
encyclopédique. Le tour du monde y est l'occasion d'un
« tour des sciences » :
les voyages de Bougainville, de Cook ou de La Pérouse
apportent une connaissance décisive à la
cosmographie, à la botanique, à la zoologie,
voire à l'ethnographie naissante, tout en revivifiant d'une
manière parfois involontaire, le vieux mythe du bon sauvage,
déplacé d'une Amérique en voie de
colonisation dont l'aura utopique s'affaiblit vers les rivages neufs de
la « Nouvelle
Cythère » polynésienne.
Ces
pérégrinations savantes, qui n'excluent pas le
cas échéant la rêverie primitiviste ou
l'exotisme voluptueux, donnent lieu en général
à des publications de deux types. Les unes purement
techniques et réservées à un cercle
étroit de spécialistes, se bornent à
consigner les résultats des observations correspondant
à l'objet officiel de la mission. Les autres, s'adressant
à un public plus large, mettent à profit le
déroulement du voyage pour produire un reportage descriptif
sur les contrées traversées et parfois prennent
l'aspect de récits événementiels,
voire de romans d'aventures vrais auxquels se mêlent
réflexions, conjectures et même confidences
personnelles.
[…]
Quant à la mission
confiée à l'abbé Pingré,
elle le conduisit […] dans l'océan Indien,
d'abord à l'île Rodrigue, la plus petite des
Mascareignes, où il effectua ses observations, puis dans les
deux autres terres de l'archipel, l'île de France et
l'île Bourbon, aujourd'hui île Maurice et
île de La Réunion. [Ce] récit est
demeuré pour l'essentiel inédit à ce
jour, peut-être desservi par un titre trop restrictif qui ne
correspond que très partiellement à son contenu.
Il est certain pourtant que l'auteur en avait envisagé la
publication, et une version soigneusement corrigée du
manuscrit initial avait été
préparée dans ce but. C'est ce texte que nous
présentons dans cette édition […].
[…]
☐
pp. 7-9
|
| EXTRAIT |
Tous les poissons que j'ai nommés sont
bons à manger. Il y a cependant une saison de
l'année où la plupart deviennent
poisons : c'est celle où le corail
est en fleur. Je me sers de l'expression seule connue dans ces
îles. L'escadre anglaise en fit une triste
expérience : j'ai dit plus haut qu'elle entra au
port de Rodrigue le 15 de septembre
[1761] ; elle en repartit le 25 de décembre, mais
après avoir perdu près de la moitié de
son équipage par des maladies qu'on a attribuées
à l'usage immodéré et indiscret du
poisson dans une saison où il commençait
à être dangereux. La vieille passe
alors pour le poisson le plus suspect de tous. En pleine mer on
pourrait pêcher des thons, des bonites,
des dorades, des marsouins,
etc., mais ces poissons approchent rarement de la côte. Les requins
sont plus hardis, ils viennent jouer sur les récifs. François Leguat
s'était persuadé que les requins de Rodrigue
n'étaient pas
malfaisants ; il s'est, dit-il, souvent baigné avec
ses compagnons, environné de grandes troupes de requins sans
qu'il leur soit arrivé aucun mal. Il est possible que les
requins de Rodrigue, trouvant une multitude de
poissons suffisante pour satisfaire leur appétit glouton,
soient moins friands de chair humaine, mais je crois que le plus
sûr est de ne pas s'y fier
inconsidérément. Un Noir de Rodrigue
sortait d'une pirogue avec deux poissons à la main, il lui
restait un petit trajet de mer à traverser où la
profondeur de l'eau était tout au plus d'un pied, un requin
se trouva sur son passage, sauta aux poissons et les enleva avec une
partie de la main du pauvre Noir.
☐ p. 181
|
|
| COMPLÉMENT
BIBLIOGRAPHIQUE |
- Alexandre-Guy
Pingré, « Voyages dans les mers de l'Inde
à l'occasion du passage de Vénus sur le soleil en
1760-61 » extraits du Voyage à
Rodrigue, Bulletin de l'Académie de La
Réunion, vol. 5, 1922, pp. 141-173
- Alexandre-Guy
Pingré, « Courser Venus : voyage
scientifique à l'île Rodrigue »
fragments du journal de voyage de l'abbé Pingré,
Sainte Clotilde (La Réunion) : ARS Terres
créoles, Rose Hill (Maurice) : Ed. de
l'océan Indien, 1993
|
- Jean-Michel
Racault, « L'observation du passage de
Vénus sur le soleil : le voyage de
Pingré dans l'océan Indien »,
Dix-huitième siècle, n° 22
(Voyager, explorer), 1990, pp. 107-120 [en ligne]
- Christophe
Migeon, « Mauvaise étoile, ou les calamiteuses mais
véridiques tribulations d'un astronome dans les mers de
l'Inde », Paris : Paulsen, 2021
|
|
|
| mise-à-jour : 10 février 2021 |
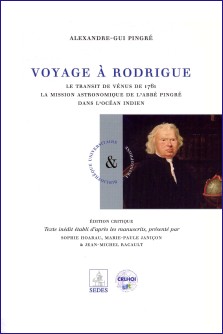
|
|
|
|