|
Aventures aux
Mascareignes : Voyages et aventures de François
Leguat et de ses compagnons en deux îles désertes
des Indes orientales, 1707 / François Leguat ;
introduction et notes de Jean-Michel Racault ; suivi de Recueil
de quelques mémoires servant d'instruction pour
l'établissement de l'île d'Eden, par
Henri Duquesne (1689). - Paris : La Découverte,
1984. - 243 p.-[8] p. de pl. ;
22 cm.
ISBN 2-7071-1483-9
|
|
JEAN-MICHEL
RACAULT :
[…]
C'est [douze ans avant
la parution de Robinson
Crusoe], en octobre 1707 1, qu'est
publié simultanément chez Jean-Louis Delorme,
à Amsterdam, et chez David Mortier, à Londres,
l'ouvrage intitulé Voyages et aventures de
François Leguat et de ses compagnons en deux îles
désertes des Indes orientales. Avec la relation des choses
les plus remarquables qu'ils ont observées dans
l'île Maurice, à Batavia, au cap de
Bonne-Espérance, dans l'île de
Sainte-Hélène et en d'autres endroits de leur
route. Une traduction anglaise paraît
à peu près simultanément,
suivie peu de temps après de versions hollandaises (1708) et
allemandes (1709) dont une, en 1723, sous le titre significatif de Der
Französische Robinson. En France, le livre
connaîtra une carrière plus qu'honorable pour
ce genre de production : on dénombre,
jusqu'au milieu du XVIIIe
siècle, quatre nouvelles éditions au moins, en
1711, 1720, 1721, 1750.
Roman ou histoire
vraie ? Le débat aujourd'hui est toujours ouvert,
bien que tous les éléments nécessaires
pour le résoudre soient depuis longtemps disponibles. Mais
peut-être les deux termes en présence ne sont-ils
pas réellement contradictoires. Le récit de
Leguat est à la fois un excellent roman, probablement le
meilleur exemple de « roman de l'île
déserte » avant Defoe, et, on peut en
apporter la preuve, le compte rendu somme toute parfaitement
véridique d'une expérience réellement
vécue.
[…]
☐ Introduction, pp. 5-6
| 1. |
L'édition
est postdatée (1708), comme c'était l'usage pour
les ouvrages parus au cours du dernier trimestre de l'année. |
|
|
« Roman ou
histoire vraie ? » — Les premiers
lecteurs 1 ont douté de la
véracité du récit de
François Leguat au point que, jusqu'à une date
récente, les critiques l'ont rangé dans la
catégorie des voyages fabuleux, à
côté des œuvres de Gabriel de Foigny ou de Simon Tyssot de Patot. En 1922,
Geoffroy Atkinson accréditait encore cette opinion dans son
ouvrage « The extraordinary voyage in French
literature from 1700 to 1720 », et c'est en
1979 seulement qu'Alfred North-Coombes put établir
formellement la vérité en
publiant « The vindication of
François Leguat ».
La méprise, et une
méprise si durable, éclaire l'étroite
parenté entre utopie rêvée et utopie
vécue, ainsi que la faiblesse des moyens permettant de
distinguer l'une de l'autre. Il est vrai que, comme nombre de
Français auteurs d'utopies avérées,
François Leguat était protestant, contraint
à se réfugier en Hollande ou en Grande-Bretagne
et, de ce fait, habile à brouiller les
pistes …
Resterait à
déterminer ce qui, parmi les aléas de destins
individuels proches, pousse les uns à écrire des
récits utopiques, comme Denis Veiras, autre huguenot
réfugié en Angleterre puis en Hollande, auteur de
« L'histoire des
Sévarambes » (1675),
et les autres, plus rares, à s'embarquer vers des
îles lointaines. Plus parfumée
la trace laissée par ces derniers n'est-elle pas plus
prenante, partant plus durable ? C'est
ce que laisse penser cette note de lecture de Chateaubriand 2 :
« Dans ces premières années de
la retraite de
Rancé, on entendit peu parler du
monastère, mais
petit à petit sa renommée se
répandit. On
s'aperçut qu'il venait des parfums d'une terre
inconnue ; on se tournait, pour les respirer, vers
les
régions de cette Arabie heureuse. Attiré par les
effluences célestes, on en remonta le cours :
l'île
de Cuba se décèle par l'odeur des vanilliers sur
la
côte des Florides. Nous étions,
dit Leguat, en présence de l'île
d'Éden : l'air était rempli
d'une odeur charmante qui venait de l'île et s'exhalait des
citronniers et des orangers [NdA : Voyages
et aventures de François Leguat, p. 48, tome Ier.]
»
| 1. |
En 1761,
l'abbé Pingré débarque à
Rodrigue pour y observer le transit de Vénus ; il a
lu le récit de Leguat et s'y réfère
à plusieurs reprises : « Cet
ouvrage passe pour un tissu de fables ; j'en ai
trouvé beaucoup moins que je ne m'y
attendais ». — « Voyage à
Rodrigue », Paris : Le Publieur
(Bibliothèque universitaire & francophone), 2004
(p. 152). |
| 2. |
« Vie de
Rancé », Livre second. |
|
| COMPLÉMENT
BIBLIOGRAPHIQUE |
- « Voyages
et aventures de François Leguat et de ses compagnons en deux
isles désertes des Indes
orientales […] »,
Amsterdam : chez Jean-Louis de Lorme, 1708
- « Les
naufragés de Dieu : aventures d'un protestant et de ses
compagnons exilés en deux îles désertes de
l'océan Indien, 1690-1698 » préface de
Jean-Pierre Sicre, Paris : Phébus (D'Ailleurs), 1995
- «
Voyage et aventures de François Leguat et de ses compagnons en
deux îles désertes des Indes orientales,
1690-1698 » introduction et notes de Jean-Michel Racault,
Paris : Les Éd. de Paris, 1995
|
- Nicolas
Cavaillès, « Vie de monsieur
Leguat », Paris : Ed. du Sonneur, 2013
- Alfred
North-Coombes, « The
vindication of François Leguat »,
Port-Louis (Maurice) : Sté de l'histoire de
l'île Maurice, 1979 ; Éd. de
l'océan Indien, 1991
|
|
|
| mise-à-jour : 4
octobre 2013 |
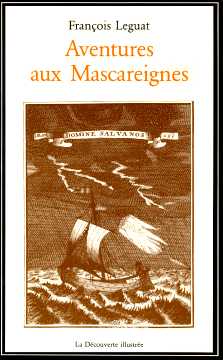
|
|
|
|