|
Territoires et
sociétés insulaires [actes du Colloque
international, Brest et Ouessant, 15-17 novembre 1989]
/ éd. par Françoise Gourmelon et Louis Brigand. -
Brest : Université de Bretagne occidentale, 1991. -
456 p. : ill., cartes ; 30 cm. -
(Recherches
environnement, 36).
|
LOUIS
BRIGAND et FRANÇOISE GOURMELON :
Le colloque “ Territoires et Sociétés
Insulaires ” (…) avait comme objectif de
rassembler
scientifiques, gestionnaires et élus afin de cerner les
évolutions contemporaines que connaissent les îles
et les
méthodologies de recherche à
développer pour
caractériser et identifier les changements qui les
affectent.
Dans cette perspective, ce colloque devait déboucher sur des
recommandations en matière d'aménagement et de
développement, mais aussi en terme de perspective de
recherche.
Essentiellement consacré aux îles de petite taille
(inférieure à 10 000 km2
selon les critères retenus par les experts de l'UNESCO 1),
le colloque a permis de présenter une quarantaine de
situations insulaires de par le monde 2.
Si les géographes ont constitué le contingent le
plus
important de la soixantaine de communicants, il convient de mentionner
la présence, parmi les chercheurs, d'écologues et
d'historiens. Cette ouverture interdisciplinaire, si importante pour
l'étude des îles, s'est doublée d'une
ouverture
internationale grâce à la présence
d'une vingtaine
de chercheurs étrangers 3.
(…)
Sur les trois journées du colloque, la première
et la dernière 4
ont été consacrées aux communications
présentées au sein de trois commissions.
➀ La
première était orientée (…)
sur
l'étude de l'insularité, des concepts qui s'y
rattachent
et des différentes approches méthodologiques
permettant
de la caractériser.
➁
La
seconde, intitulée “ les hommes et l'espace
insulaire
”, abordait (…) les questions relatives
à la
démographie, aux activités
économiques, notamment
au tourisme et aux transports.
➂
La
troisième, en se consacrant aux aspects liés
à la
gestion des ressources à l'aménagement et au
développement, a permis de passer du champ de la
conceptualisation et des études de cas, au champ de l'action
et
des recommandations.
(…)
☐ Avant-propos,
p. 7
| 1. |
La Corse ou Chypre couvrent chacune moins de
9 000 km2
; la Sardaigne 24 000 km2, la Sicile plus de 25 000 km2. |
| 2. |
Des
îles proches (Ouessant, Molène, Sein,
…) aux plus
lointaines (îles côtières du Japon,
Nouvelle-Calédonie, Vanuatu, Tonga, …) en passant
par le
bassin méditerranéen, les parages africains ou
américains. |
| 3. |
Venus
de Belgique, Canada, Espagne, Grèce, Irlande, Italie,
Pays-Bas,
Portugal, Suède, U.S.A., Vanuatu, Yougoslavie. |
| 4. |
“ La
seconde journée du colloque s'est tenue sur l'île
d'Ouessant. La visite de l'île et les rencontres avec les
autorités locales ont été l'occasion
pour les
participants de faire connaissance avec l'une des plus remarquables de
nos îles du Ponant. ” — Louis
Brigand et
Françoise Gourmelon, ibid. |
|
|
La
prise de conscience dans les îles du caractère
rare
et limité de l'espace coïncide avec la prise de
conscience par
l'opinion publique mondiale que la planète Terre est aussi
un espace
limité, une forme d'île dans le vaste Univers.
☐ Patrick Singelin et
Jean-Yves Monnat — Conclusions,
p. 435 |
L'ampleur
du champ ouvert aux intervenants, le nombre, la diversité
(et la
qualité) des contributions ne permettent pas un commentaire
d'ensemble approfondi. Quant à un choix il serait
nécessairement aussi partial que partiel. On ne retiendra
donc
ici qu'un rappel simplifié des conclusions tirées
à l'issue du colloque par les rapporteurs de chacune des
trois
commissions.
➀ Très naturellement, la première
commission chargée de préciser les concepts
liés
à l'insularité et aux méthodologies
permettant de
la caractériser ne pouvait qu'émettre un
(relatif)
constat d'échec : “ il peut
être difficile
de résister à la tentation d'imaginer une
spécificité insulaire (…). Pourtant,
il faut
reconnaître que la diversité des îles
(…)
rend cette perspective hasardeuse. Dans ce cas, il vaut mieux
(…) faire nôtre le conseil de Circé
à
Ulysse : prendre garde aux illusions et maintenir le cap sur
des
objectifs plus réalistes, en l'occurrence la description
raisonnée des milieux insulaires
(…). ”
— Guy Mercier, Rapport
du thème 1 : Étude de
l'insularité, p. 426.
➁
Dans leurs conclusions, les rapporteurs de la deuxième
commission émettent “ trois propositions
complémentaires ” :
- réhabiliter
“ la recherche géographique
historique ”
pour mieux prendre en considération les
évolutions
“ sur le très long
terme ” ;
- promouvoir
la création d'une
“ délégation
régionale aux risques majeurs ”
destinée
à prévenir et à parer aux
conséquences des
séismes, éruptions volcaniques ou
phénomènes météorologiques
violents en
Guadeloupe, Martinique (et en Guyane) ainsi qu'à La
Réunion ;
- “ parier
sur l'homme, le former, lui faire confiance (…) les facteurs
éducation et communication n'ont peut-être pas
été suffisamment développés
(…). ” — Jean-Marie
Becet et Guy Mainet, Rapport
du thème 2 : Les hommes et l'espace
insulaire, p. 432.
➂
La troisième et dernière commission,
orientée sur
l'action et les perspectives de développement, aurait pu
proposer, au terme de ses travaux, un catalogue d'initiatives
à
entreprendre. Les
rapporteurs ont pourtant retenu des conclusions de portée
générale, formulées en
préalable aux
projets
à mettre en œuvre :
“ L'espace insulaire
étant par définition bien
délimité, les
acteurs de l'aménagement peuvent plus aisément
que sur le
continent percevoir le caractère fini des ressources, en
termes
d'espace, de disponibilité en eau, de linéaire de
littoral … C'est peut-être la raison pour
laquelle
chercheurs et spécialistes se passionnent si volontiers pour
l'espace insulaire : il constitue en effet un lieu
idéal
d'investigation, d'où l'exemplarité des
expériences insulaires en matière
d'aménagement du
territoire et le caractère souvent novateur des solutions
proposées ”. — Patrick
Singelin et
Jean-Yves Monnat, Rapport
du thème 3 : Gestion des ressources et
aménagement des îles, p. 434.
Autrement dit, les îles sont aux avant-poste des
évolutions majeures qui touchent la planète
entière ; constat reformulé plus loin
avec vigueur
et qui mériterait de servir de conclusion
générale
à l'ensemble du recueil : “ la
prise de
conscience dans les îles du caractère rare et
limité de l'espace coïncide avec la prise de
conscience par
l'opinion publique mondiale que la planète Terre est aussi
un
espace limité, une forme d'île dans le vaste
Univers ”. — Patrick
Singelin et Jean-Yves
Monnat, ibid.
Une injonction qui mérite d'être
très largement entendue !
|
| COMPLÉMENT
BIBLIOGRAPHIQUE |
- Françoise
Gourmelon (dir.),
« Atlas de la réserve de
biosphère de la mer
d'Iroise : exploitation cartographique de la base
d'information
géographique Sigouessant »,
Hanvec : Parc naturel régional d'Armorique, 1995
|
- Louis
Brigand, « Enez
Sun : carnet
d'un géographe à l'île de Sein »,
Brest : Dialogues, 2017
- Louis
Brigand, « Les
néo-entrepreneurs des îles, moteur d'un renouveau
économique ? » in Eric
Fougère
(éd.), Île,
état du lieu, Paris :
Téraèdre (Cultures &
sociétés - Sciences de l'homme, 40), 2016
- Louis
Brigand, « Besoin d'îles »,
Paris : Stock, 2009
- Louis
Brigand, « Les îles du
Ponant : histoires et géographie des îles
et archipels de la Manche et de l'Atlantique »,
Quimper : Éd. Palantines, 2002
- Louis
Brigand (et al.),
« Les
îles en Méditerranée : enjeux
et perspectives », Paris :
Economica, 1991
|
|
|
| mise-à-jour : 3
octobre 2019 |
BREST
: ÎLES 2019
regards
croisés des sciences, des cultures et de la
société
14 ➢ 19
octobre 2019 |
|
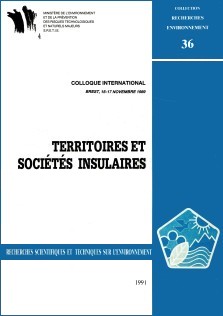 |
|
|
|