|
The Isle of Pines, or, A late
discovery of a fourth island in Terra Australis incognita / George Pine [i.e. Henry Neville]. - Londres : Allen
Banks and Charles Harper, 1668. - 9 p.-pl. ;
19 cm.
|
|
SERGE
SOUPEL :
L'Angleterre possède avec le très court The
Isle of Pines (1668) de Henry Neville un cas remarquable.
Quatre femmes et un homme sont échoués sur une
île et y vivent assez bien et assez longtemps
(après avoir récupéré des
marchandises sur leur navire naufragé) pour se
multiplier au point qu'à la mort de l'homme, George Pine,
devenu arrière-grand-père à
quatre-vingts ans, l'île est peuplée de 1788
âmes (cinquante-neuf ans après le naufrage). On
crut à cette fable […] mais moins en Angleterre
qu'ailleurs, et Dryden dans son Mr. Limberham s'en
moqua autant que le fit Richard Head dans le pastiche Western
Wonder.
☐ Introduction
(p. 19), in : Daniel Defoe, « Vie
et aventures de Robinson Crusoe », Flammarion (GF,
551) : Paris, 1989
|
|
MICHEL
TRÉMOUSA : En
1668 parut à Londres le récit The Isle
of Pines, or A late discovery of a forth island near Terra Australis
incognita, de Henry Neville (1620-1694). Des traductions
en furent publiées dans toute l'Europe. Ce bref
récit de neuf pages inspira un roman allemand de plus de
quatre cents pages 1, L'Histoire
curieuse et véridique de Joris Pines, natif de Dublin en
Irlande. Où sont décrits en détail son
arrivée et son séjour d'une
durée de soixante-dix ans dans une île
désolée des Terres Australes en compagnie de ses
quatre femmes, savoir une négresse et trois
Blanches ; ainsi que les aventures étonnantes qui
lui advinrent dans cette île, sa nombreuse
descendance, l'institution de la polygamie continuée
par ses descendants les Pinésiens, son testament et
ses lois, la discorde entre ses enfants, leur conduite incestueuse
commandée par la nécessité ;
de même que leurs échanges avec les
naturels de ces contrées, les moeurs et les
coutumes étranges qui régnaient parmi eux.
☐ Notes
du traducteur
(pp. 297-298), in : Johann Gottfried Schnabel,
« L'île
de Felsenburg », Paris : Fayard,
1997
| 1. |
« Quant à l'histoire
de Joris ou George Pine, elle a pour elle, depuis
l'an 1667, d'avoir un certificat de naissance passable, mais depuis
qu'un anonyme prétend l'avoir traduite de l'anglais en
allemand en la réchauffant à la façon
d'un plat de choucroute relevé de groseilles vertes, il en
est résulté un tel pot-pourri qu'on a peine
à y retrouver les quelques parcelles de
vérité réduites en bouillie qui nagent
au fond de la sauce allongée. D'où il suit que
quiconque n'a pas déjà lu cette histoire dans
d'autres livres la tiendra pour pure invention et
conséquemment jettera l'enfant avec l'eau du
bain. » — Johann Gottfried
Schnabel, « L'île de
Felsenburg » op. cit., Préface
de l'auteur, p. 12 |
|
| COMPLÉMENT BIBLIOGRAPHIQUE | - [Henry
Neville], « Nouvelle decouverte de l'isle Pinés
située au delà de la ligne
æquinoctiale », Paris : chez Sébastien
Mabre-Cramoisy, 1668
| - Onofrio Nicastro
(ed.), « Henry Neville e L'Isola di Pines,
col testo inglese e la traduzione italiana di The Isle of
Pines », Pisa : SEU, 1988
- Susan Bruce
(ed.), « Three modern utopias : Utopia
(Thomas More), New Atlantis (Francis Bacon), The
Isle of Pines (Henry Neville) »,
Oxford : Oxford university press (Oxford world's classics),
1999
| - Chauncey
Worthington Ford, « The Isle of Pines,
1668 : an essay in bibliography »,
Boston : The Club of odd volumes, 1920
- Pierre Lurbe,
« Une utopie inverse : The Isle
of Pines de Henry Neville (1668) »,
Bulletin de la Sté d'études
anglo-américaines des XVIIe
et XVIIIe
siècles, vol. 38, juin 1994
- Sophie Jorrand,
« Le discours narratif dans The Isle of
Pines d'Henry Neville : enchâssements et
décalages », Cahiers Réforme
et contre-Réforme (Université Blaise Pascal),
n° 6, juin 2002
|
|
|
| mise-à-jour : 4
novembre 2005 |
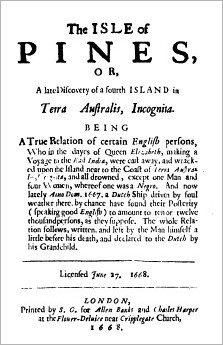
|
|
|
|