|
Sartorius, le roman des
Batoutos / Edouard Glissant. - Paris : Gallimard, 1999. -
352 p. ; 21 cm.
ISBN 2-07-075652-1
|
|
… dans
l'assomption des nouvelles du monde, les deux paysages, le nilotique et
l'insulaire au loin, se touchent et se comprennnent. Ichneumon et Laoka
s'accordent à nouveau, pour célébrer
le regard
recomposé du dieu.
☐ Edouard
Glissant, Les Grands
Chaos
L'œil
dérobé, Présentation
|
RENÉ DE CECCATTY :
En suivant
à travers les siècles le destin du peuple
imaginaire des Batoutos, Edouard Glissant s'aventure sur le terrain de
l'ethnologie politique et fantastique. Comme il l'a fait le plus
souvent dans ses romans, l'écrivain antillais
mène de front une réflexion théorique
sur le statut de la fiction, un projet romanesque cohérent
mais très proche de l'autobiographie intellectuelle et une
esquisse poétique qui nous vaut ici des pages d'une
très grande liberté lyrique.
[…]
Sartorius met donc en scène
un peuple symbolique, synthétique de tous les peuples
d'Afrique qui ont été
démantelés, massacrés par la traite
des négriers. Les Batoutos sont, à eux seuls,
chargés de représenter tous ceux qui ont perdu
non seulement leur histoire, mais leur mémoire et leur
visibilité même. A quel prix, se demande Glissant,
tout au long de ce roman-essai-poème, les Blancs se sont-ils
dédouanés de cette culpabilité de
l'esclavage ? Comment, dans la littérature, les
Noirs apparaissent-ils ? Comment fabrique-t-on une
minorité ? Comment s'en accomode-t-on ?
[…]
Donc,
les Batoutos. Ce mot inventé rencontre tant de proches
sonorités, qu'on finit, comme l'auteur l'admet vers le
milieu de son livre, par penser qu'il désigne une population
réelle. Un ami malien de Glissant lui garantit que ce peuple
existe. Mais les dictionnaires n'en portent aucune trace. Et les
Bantous ? Et les Batwas pygmées ? Et les
Batutsis, premier nom des Tutsis ? Et le voyageur arabe Ibn
Battuta ? Le propre de ce peuple est d'être
invisible, ou plutôt, comme le précise Glissant,
visible, mais « invu ».
Il parcourt l'histoire en étant nié.
[…]
On
sait la générosité très
universaliste de Glissant. Sa description d'un destin collectif
imaginaire est pour lui l'occasion de répéter sa
conviction que « l'éclat d'un
peuple est d'arrimer la beauté de son lieu à la
beauté de tout l'existant ».
Cette thèse va de pair avec une autre qui concerne non plus
la collectivité mais les individualités dans
cette collectivité : « Les
existences accumulées, dans leur quotidienne et fugace et
ordinaire course, produisent plus que ne font tant d'œuvres
d'exception, effigies de dieux ou masques des ancêtres ou
contes débordant de héros ou de malins
génies, qui prétendent porter à bien
ou à mal ». La
littérature antillaise, plus que la littérature
africaine, s'est attachée à comprendre ce
phénomène qui concerne l'histoire des cultures,
mais aussi la fonction de l'oralité.
☐ Le Monde des livres, 19
novembre 1999
|
PATRICK
CHAMOISEAU :
Les hommes de poésie pure demeurèrent hors des
projections fulgurantes de Sapiens, peu visibles, peu
déterminants, sans souci de conquête ou de
domination,
comme un peuple qui ne serait d'aucun peuple, d'aucun territoire, mais
qui les féconderait tous d'un quelque chose qui nous habite
encore. Glissant, qui devina leur existence, qui sut
peut-être en
surprendre quelques-uns, les appela : Batoutos.
Tu imagines cette manière participante d'être au
monde,
d'en être mais de ne pas y être, d'y être
et de ne
pas en être ?
☐ « La matière
de l'absence », p. 266
|
| COMPLÉMENT
BIBLIOGRAPHIQUE |
- « Tout-monde »,
Paris : Gallimard, 1993
|
- « Un
champ d'îles », Paris : Instance,
1953
- « La
terre inquiète » avec un frontispice de
Wifredo Lam, Paris : Éd. du Dragon, 1955
- « Les
Indes », Paris : Falaize, 1956 ;
Paris : Seuil, 1965, 1985
- « Soleil
de la conscience », Paris : Seuil, 1956
- « La
Lézarde », Paris :
Seuil, 1958, 1984, 1995 ; Gallimard, 1997
- « Le
sel noir », Paris : Seuil, 1960
- « Monsieur
Toussaint », Paris : Seuil, 1961, 1986
- « Le
sang rivé », Paris :
Présence africaine, 1961
- « Le
quatrième siècle »,
Paris : Seuil, 1964 ; Gallimard (L'Imaginaire, 233),
1990
- « Un
champ d'îles (suivi de) La terre inquiète (et de)
Les Indes », Paris : Seuil, 1965
- « L'intention
poétique », Paris : Seuil, 1969
- « Malemort »,
Paris : Seuil, 1975 ; Gallimard, 1997
- « Boises :
histoire naturelle d'une aridité »,
[Fort-de-France] : Acoma, 1979
- « Le
discours antillais », Paris : Seuil,
1981 ; Gallimard (Folio essais, 313), 1997
- « La
case du commandeur », Paris : Seuil,
1981 ; Gallimard, 1997
- «
Le sel noir (suivi de) Le sang rivé (et de)
Boises », Paris : Gallimard
(Poésie, 175), 1983
- « Pays
rêvé, pays réel »,
Paris : Seuil, 1985
- « Mahagony »,
Paris : Seuil, 1987 ; Gallimard, 1997
- « Poétique
de la relation (Poétique, III), Paris : Gallimard,
1990
- « Fastes »,
Toronto : Ed. du GREF, 1991
- « Tout-monde »,
Paris : Gallimard, 1993 ; Gallimard (Folio, 2744),
1995
- « Poèmes
complets (Le sang rivé ; Un champ d'îles ; La
terre inquiète ; Les Indes ; Le sel noir ; Boises ; Pays
rêvé, pays réel ; Fastes ; Les grands
chaos) », Paris : Gallimard, 1994
- « Faulkner,
Mississipi », Paris : Stock,
1996 ; Gallimard (Folio essais, 326), 1998
- « Introduction
à une poétique du divers »,
Paris : Gallimard, 1996
- « Soleil
de la conscience (Poétique, I), Paris : Gallimard,
1997
- « L'intention
poétique (Poétique, II) »,
Paris : Gallimard, 1997
- « Traité
du tout-monde (Poétique, IV), Paris : Gallimard,
1997
- « Monsieur
Toussaint (version scénique), Paris : Gallimard,
1998
- « Le
monde incréé :
poétrie », Paris : Gallimard,
2000
- « Pays
rêvé, pays réel (suivi de) Fastes (et
de) Les Grands chaos », Paris : Gallimard
(Poésie, 347), 2000
- « Iguanes,
busards, totems fous : l'art primordial de Wifredo
Lam » in Christiane Falgayrettes-Leveau (et al.) Lam métis,
Paris : Dapper, 2001
- « Ormerod »,
Paris : Gallimard, 2003
- « La
cohée du lamentin (Poétique, V), Paris :
Gallimard, 2005
- « Les Indes, Lézenn »
éd. bilingue, texte créole de Rodolf Etienne,
Paris : Le Serpent à plumes, 2005
- « Une
nouvelle région du monde (Esthétique,
I) », Paris : Gallimard, 2006
- « Mémoires
des esclavages », Paris : Gallimard, 2007
- « Quand
les murs tombent : l'identité nationale
hors-la-loi ? » avec Patrick Chamoiseau,
Paris :
Galaade, Institut du Tout-Monde, 2007
- « La
terre magnétique : les errances de Rapa Nui,
l'île de
Pâques » en collaboration avec
Sylvie Séma,
Paris : Seuil (Peuples de l'eau), 2007
- « L'intraitable
beauté du monde : adresse à Barack
Obama » avec Patrick Chamoiseau, Paris :
Galaade,
Institut du Tout-Monde, 2009
- « Philosophie de la
relation : poésie en étendue »,
Paris : Gallimard, 2009
- « 10
mai : mémoires de la traite
négrière, de
l'esclavage et de leurs abolitions »,
Paris : Galaade,
Institut du Tout-Monde, 2010
- « La
terre, le feu, l'eau et les vents : une anthologie de la
poésie du tout-monde », Paris :
Galaade,
Institut du Tout-Monde, 2010
- « L'entretien
du monde » entretiens avec
François Noudelmann, Saint-Denis : Presses
universitaires de Vincennes, 2018
- «
Manifestes » avec Patrick Chamoiseau,
Paris : La Découverte, Institut du Tout-Monde, 2021
|
|
|
- Romuald
Fonkoua, « Essai
sur une mesure du monde au XXe siècle :
Édouard Glissant »,
Paris : Honoré Champion, 2002
- François
Noudelmann, Françoise Simasotchi-Bronès (et al.),
« Édouard
Glissant, la pensée du détour »,
Paris : Larousse, Armand Colin (Littérature, 174),
2014
- François
Noudelmann, « Edouard
Glissant, l'identité
généreuse », Paris :
Flammarion (Grandes
biographies), 2018
- Aliocha
Wald Lasowski, « Edouard Glissant :
déchiffrer le monde », Montrouge :
Bayard, 2021
|
Sur le site « île en
île » : dossier Edouard Glissant
Centre
international d'études Edouard Glissant |
|
|
| mise-à-jour : 12 juillet 2021 |
Né à Sainte-Marie
(Martinique) en 1928,
Edouard
Glissant est décédé
à
Paris le 3 février 2011. |
|
|
|
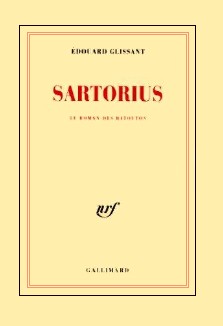
|
|
|
|