|
Les Marquisiens et leur
art : l'ornementation primitive des mers du Sud (vol. 2)
Plastique / Karl von den
Steinen ; [nouv.
éd. ; trad. revue et corrigée]. - Papeete : Au Vent des
îles, Musée de Tahiti et des îles, 2016.
- 296 p. : ill., cartes ; 31 cm.
ISBN 978-2-36734-071-5
|
|
... le dieu était
initialement représenté afin que son image le
tienne subjugué magiquement.
☐ Avant-propos
|
La première partie
présente dans ses grandes lignes la
« culture matérielle »
des habitants de l'archipel : habillement et parure, maison,
alimentation et outillages, navigation et pêche, armes et
insignes d'autorité, instruments de musique, sports et jeux,
ficelles à nœuds, objets sacrés, huttes
funéraires et marae.
Mais
la plus grande partie
de l'ouvrage est occupée par les chapitres
consacrés à « l'art du
tiki » ; ces figures anthropomorphiques
sont étudiées sous toutes leurs
formes — sculpture monumentale sur pierre ou sur
bois, sculpture ornementale (pierre, bois, os, ivoire,
écaille) ou gravure. L'acuité du regard,
l'ampleur du recensement, la qualité de l'analyse des
styles, de leur évolution dans le temps et de leurs
variantes locales, toutes ces qualités font de
« l'art du tiki » le pendant de
la magistrale étude du tatouage
contenue dans le premier volume.
Karl
von den Steinen a mené son enquête
aux îles Marquises d'août 1897 à
février 1898 ; il ne subsistait plus alors dans
l'archipel que de rares pièces anciennes
rescapées des pillages et destructions causés par
les visiteurs occidentaux sur un rythme croissant tout au long du XIXe
siècle. Pour mener à bien son investigation, Karl
von den Steinen complète la collecte de terrain par sa
connaissance des différentes collections publiques ou
privées en Europe et en Amérique du nord, ainsi
qu'en puisant dans l'abondante littérature qui leur est
consacrée ; mais cette approche est constamment
vivifiée par les informations, points de vue et analyses
recueillis sur place auprès des derniers
détenteurs de la culture classique marquisienne —
toujours écoutés avec un profond respect, qui
n'exclut ni le retrait de la réflexion, ni, très
souvent, l'humour … et l'aptitude à en
reconnaître les manifestations 1.
L'ouvrage s'accompagne d'une abondante
iconographie : une partie en est reportée dans le
troisième et dernier volume, intitulé
« Les Collections ».
| 1. |
Ainsi lit-on, au détour d'un long
développement sur les
chemins d'un art sans liberté :
« à ce stade d'un art stylisé
(qu'il s'agisse
du dessin tatoué ou de la sculpture de personnages), je
voudrais
montrer que le mythe, de même qu'il devient en
littérature
une légende distrayante, n'est pas inaccessible à
la
fantaisie artistique et lui prête volontiers ses
motifs ». |
|
| EXTRAIT |
On ne réalise que trop peu, et trop
rarement, l'abîme terrible qui s'est ouvert parmi les
indigènes entre la génération du
grand-père et celle du petit-fils, et aucune personne
honnête ne peut méconnaître la profonde
tragédie qui a frappé l'existence du premier,
à tout le moins, du fait d'un total déracinement.
Subitement, il n'y eut plus de prêtres, plus de chefs, plus
de guerriers, plus de guerres tribales, plus de tiki
de bois ou de pierre ; plus d'ornements de plumes d'oiseaux,
de dent de cachalot, de barbe de vieillard ou de la chevelure aux
boucles noires des parents ; plus de bâton de chef
portant au pommeau un lézard ou un etua,
plus de véritable éventail de
cérémonie au manche sculpté, plus de
véritable pagaie-massue ou de massue, plus de fronde et de
pierre de fronde, plus de trompe en coquillage, plus de tambour tendu
de peau de requin, plus d'échasses aux marchepieds
sculptés. Tous les lieux sacrés
tombèrent en ruines dans la brousse tropicale
proliférante. Désormais, tabu
était le tatouage, tabu le kava,
tabu la nudité. Il n'y avait presque plus de tapa
blanc pour envelopper les morts, et plus personne ne pensait
à planter un mûrier pour chaque
nouveau-né. Le voyageur n'est plus averti du prochain
village par le son lointain des ike battant le tapa.
Tout, tout ce qui avait été la coutume et la
tradition, la religion et le culte, le savoir, l'art et l'artisanat ne
vivait plus que dans le souvenir des vieux, aigris et à qui
le bonheur de la civilisation restait incompréhensible et
détesté. La jeune
génération, par contre, nommait « tiaporo »
(diable) l'ancien dieu etua, et entendait
à l'école de la mission [un] petit pamphlet dans
lequel l'image de l'ancêtre déifié est
abaissée au rang de bête de somme et sera
attelée à la carriole chargée de
pierres, de sable et de bois de feu.
C'est sur ce sol ingrat qu'a poussé
(à part rares exceptions) tout ce qui fut sculpté
et gravé depuis la fin du XIXe
siècle dans les îles, bien sûr avec des
outils de fer et d'acier. Depuis longtemps, la plupart des objets de
valeur a été détournée par
les visiteurs étrangers, si bien qu'on n'avait
même plus de modèles authentiques. Mais les
collectionneurs payaient bien ; et une
génération devenue épigone par
nécessité fabriqua et fabrique encore des
récipients surchargés de sculpture, des
« massues », des
« pagaies », sans oublier les tiki
de pierre, qui sont livrés aux
musées, parfois en abondance. On voit
immédiatement que ces objets ne furent jamais
utilisés et, ce qui est le plus original, n'auraient jamais
pu être utilisés ! Ils sont simplement
des productions artificielles de « l'industrie
touristique » ; c'est une appellation peu
amicale mais qui est juste et doit être de loin
préférée au terme dépourvu
de sens « objet
cérémoniel », qui cache mal
l'embarras. Les réalisations de meilleur niveau seront
volontiers reconnues comme témoignages des dons et de
l'originalité des tuhuna !
☐ Au tournant du
siècle
|
|
| COMPLÉMENT
BIBLIOGRAPHIQUE |
- « Die
Marquesaner und ihre Kunst : Studien über die
Entwicklung primitiver Südseeornamentik nach eigenem
Reiseergebnissen und dem Material der
Museum » 3 vol., Berlin :
D. Reimer (E. Vohsen), 1925-1928
- « Die
Marquesaner und ihre Kunst : Studien über die
Entwicklung primitiver Südseeornamentik nach eigenem
Reiseergebnissen und dem Material der
Museum » 3 vol., New York : Hacker
art books, 1969
- « Die
Marquesaner und ihre Kunst : Studien über die
Entwicklung primitiver Südseeornamentik nach eigenem
Reiseergebnissen und dem Material der
Museum » 3 vol.,
Saarbrücken : Fines Mundi GmbH, 2008
|
- Karl von den
Steinen, « L'art du tatouage aux
îles Marquises » ill. et textes
choisis et traduits par Denise et Robert Koenig et Julia
Nottarp-Giroire, Papeete : Haere po, 2005
- Karl von den
Steinen, « Les Marquisiens et leur
art » 3 vol., Papeete :
Musée de Tahiti et des îles, Le Motu, 2005-2008
|
|
|
- Karl von den
Steinen, « Mythes marquisiens »
vol. I, Papeete : Haere po, 1997
- Karl von den
Steinen, « Mythes marquisiens »
vol. II, Papeete : Haere po, 1998
- Karl von den
Steinen, « Mythes marquisiens »
vol. III, Papeete : Haere po, 1999
- Karl von den
Steinen, « Mythes marquisiens »
éd. revue et augmentée, Papeete : Haere
po, 2005
- Karl von den
Steinen, « Kena,
une légende du tatouage marquisien
— Ha'akakai 'enata » trad. du marquisien d'après le carnet
de terrain de Hiva'oa 1897-1898,
Papeete : Haere po, 2014
|
|
|
|
|
| mise-à-jour : 5
avril 2016 |
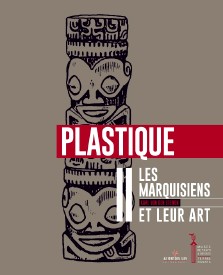
|
|
|
|