|
La fête de la
déesse Matsu / Wang Wenxing ; traduit du chinois
(Taïwan) par Camille Loivier. - Cadeilhan : Zulma,
2004. - 164 p. ; 21 cm.
ISBN 2-84304-263-1
|
|
Comme nombre de ses concitoyens,
Wang Wenxing est né hors de Taiwan — en
Chine continentale ; ainsi appartient-il à la
dernière vague des migrations dont le flux
régulier, depuis le XVIIe
siècle, a façonné le peuplement mais
aussi la vie la plus intime de l'île, baptisée par
les Portuguais Formosa, la
“ Belle ”.
Les huit nouvelles du recueil
datent des premiers temps consécutifs à
l'installation de ces derniers migrants fuyant en nombre
l'émergence, sur le continent, du nouveau pouvoir de la
Chine populaire (né en 1939, Wang Wenxing avait dix ans lors
de l'installation de sa famille à Taiwan).
Ici ou là, de
brèves notations signalent l'impact sur ce microcosme
d'influences plus lointaines, dont on pressent qu'elles exerceront
durablement leurs effets ; ainsi quand le héros
d'une des nouvelles, sur le point de prendre une décision
irréversible, murmure ces mots (en anglais dans le
texte) : “ but how loathsome and
ugly it was ! ”.
| ❙ |
Wang
Wenxing (王文興) est l’un des plus grands écrivains
taïwanais
du XXe siècle. Orfèvre de la langue, il en joue
comme
Joyce jouait de l’anglais, et ses romans, surtout le dernier,
ont
la complexité de Ulysses.
Il aura passé près de trente ans à
écrire
le second, treize ans à rédiger le
troisième.
L’œil pétillant d’ironie
derrière ses
lunettes, il dit écrire une trentaine de
caractères par
jour … Il n’a pas
d’équivalent sur le
Continent.
Né à Fuzhou (福州), dans le Fujian, en 1939,
Wang Wenxing est parti à Taiwan avec sa famille en 1946.
Après deux ans dans une petite ville du sud de
l’île, ses parents se sont installée en
1948
à Taipei, et c’est là que Wang Wenxing
a grandi.
— La Nouvelle dans la Littérature
Chinoise Contemporaine [en
ligne] |
|
| EXTRAIT |
Ah ! cette brave vieille femme, je me
souviens encore de son large visage brun, sombre comme du pain noir,
à la fois tendre et luisant, visage empli de
bonté simple et d'amour sincère. Je ne sais pas
ce qu'elle est devenue. Personne ne l'a su. Au fur et à
mesure que j'ai grandi, j'ai de moins en moins rencontré de
femmes aussi braves. Je pense qu'il n'était pas facile pour
elle de survivre dans une société
pressée de s'industrialiser. Grâce à un
étrange don d'observation que je possédais dans
mon enfance, je me souviens d'un détail. Comme je regardais
souvent ses pieds nus glisser sur notre parquet bien ciré,
j'avais remarqué qu'elle avait les doigts de pieds en
éventail. Si je l'avais remarqué, c'est parce
qu'à la maison on portait de pantoufles. Il y en avait
toujours devant la porte pour les invités. E Bashang ne
s'était pas encore soumise à cette habitude des
immigrés, elle n'en portait jamais. Dans ma toute petite
cervelle d'enfant, je me demandais où trouver des pantoufles
suffisamment grandes pour qu'elle pût les mettre.
☐
Premier amour,
p. 14
|
|
| COMPLÉMENT
BIBLIOGRAPHIQUE |
- « Processus
familial », Arles : Actes sud, 1999
- « Un homme dos à la mer », Montmorillon : Vagabonde, 2022
|
Taiwan sur le site des
littératures insulaires
En l'absence d'une sélection suffisamment
développée, la liste qui suit regroupe des
références dispersées sur l'ensemble
du
site ;
y figurent des ouvrages de fiction, des récits de
voyage, des essais et études. |
- Elliot
Ackerman and James Stavridis, « 2034 :
a novel of the next world war », New
York : Penguin press, 2021
- Véronique
Arnaud, « Ancêtres extraordinaires,
phénomènes et rites (Botel Tobago,
Taiwan) »
in Imagi-Mer :
créations fantastiques, créations mythiques,
éd. par Aliette Geistdoerfer, Jacques Ivanoff et Isabelle
Leblic, Paris : CETMA, 2002
- Maurice Auguste Beniowski, « Mémoires et voyages »,
Paris : Phébus, 2010
- Melissa J. Brown, « Is Taiwan Chinese ? The impact
of culture, power, and migration on changing identities »,
Berkeley : University of California press, 2004
- Jean-Pierre Cabestan, « Le système politique de
Taïwan : la politique en République de
Chine aujourd'hui », Paris :
Presses universitaires de France, 1999
- Christine Chaigne, Catherine Paix et Chantal Zheng
(éd.), « Taïwan :
enquête sur une identité »
Paris : Karthala, 2000
- Gwennaël
Gaffric (éd. et trad.),
« Taipei : histoires au
coin de la rue », Paris :
L'Asiathèque, 2017
- Hwang Sok-yong, « Shim Chong, fille vendue »,
Paris : Zulma, 2009
- Gilles Laurendon, « Les buveurs d'infini »,
Paris : Belfond, 2003
- Qiu Miaojin, « Les carnets du crocodile
», Paris : Noir sur blanc, 2021
- Syaman
Rapongan, « Les yeux de l'océan — Mata nu
Wawa », Paris : L'Asiathèque, 2022
- Shih Shu-Ching, « Elle s'appelle Papillon »,
Paris : L'Herne, 2004
- Scott Simon, « Sadyaq Balae !
L'autochtonie formosane dans tous ses états »,
Québec : Presses de l'université Laval,
2012
- Guo Songfen, « Récit de lune »,
Paris : Zulma, 2007
- Wu Ming-yi,
« L'homme
aux yeux à facettes »,
Paris : Stock (La Cosmopolite), 2014
- Wu Ming-yi, « Le magicien sur la passerelle
», Paris : L'Asiathèque, 2017
|
|
|
| mise-à-jour : 10 octobre 2022 |
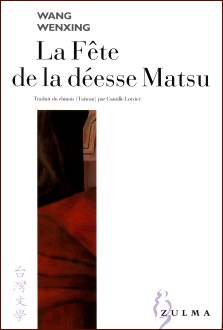
|
|
|
|