|
L'empreinte à
Crusoé / Patrick Chamoiseau. - Paris : Gallimard,
2012. - 255 p. ; 21 cm.
ISBN
978-2-07-013618-6
|
|
L'écriture
explore, il faut la laisser creuser, aller à ses hasards
dans la
situation, et être gourmand de ce qu'elle ramène
d'inattendu. Il faut lui faire fête quand elle
ramène
l'inattendu, la dresser à cela, à la
liberté des
trouvailles …
L'atelier de l'empreinte.
Chutes et notes, p. 239 |
Destin paradoxal d'un roman qui se déroule pour sa
plus
grande part hors de la scène sociale,
« Robinson Crusoé »
n'a jamais
cessé de susciter de nouvelles variations. Quand
à son tour Chamoiseau installe son héros sur le
territoire balisé par Daniel Defoe, il s'applique dans un
premier temps à respecter le legs inaugural :
l'homme qu'il
donne à entendre, et qui se croit seul rescapé
d'un
naufrage, semble avancer dans les pas de Robinson,
éprouver les mêmes sensations et
emprunter jusqu'à ses manies. Mais il apparaît
vite que
Chamoiseau entend soumettre à ses lecteurs une autre
histoire. Son Robinson
ne parle pas comme celui de Defoe : au fil du sinueux
monologue
qu'il déploie sonne un accord qui laisse pressentir une
inflexion de l'aventure.
Au premier temps du
récit, l'idiot
lesté de vingt ans de solitude qui se déplace ici
et
là dans l'île a perdu la
mémoire — qui il
était avant le naufrage,
d'où il venait. Mais il se sait humain,
civilisé ;
à la masse
hostile de
l'île, il répond par des routines ou des
rituels,
pour prévenir et contrer l'inconnu qui rôde
à
l'entour et conjurer ses propres faiblesses. Comme Robinson, il arpente
et clôture ses domaines, compte, classe et
thésaurise
ses ressources. Arrive le jour où il découvre,
sur la
grève, l'empreinte d'un pied :
« c'était
une empreinte d'homme » (p. 43). Au choc
répond
une totale déroute
— s'ouvre alors la voie vers de nouveaux modes
d'être dans l'île, d'être au monde.
Vient
un deuxième temps, celui de la petite personne, puis
un troisième, celui de l'artiste.
L'île se dévoile sous le regard du
naufragé qui,
comme par reflet, connaît une successions de mues ;
sous ses yeux le monde se transfigure, se réenchante, déborde
de présences,
se décentre, s'archipélise
— un éventail indéfiniment
déployé de perceptions est
sollicité :
« il ne se passait plus une seconde sans que je
vérifie si ce que je percevais sur le moment
était en
accord avec le possible de ce lieu »
(p. 83) ; la
conscience doit accueillir jusqu'à l'indicible, l'inconnaissable,
« ce Quoi
que le faste naturel de l'île me laissait supposer, et qui
était en elle, tout comme il était en
moi »
(p. 218). Derniers mots du naufragé quand, au terme
de son immobile
aventure, il
a retrouvé la compagnie des hommes :
« je
fermais avec vous la boucle ultime d'une immense
rencontre … » (p. 221).
Ce
parcours — qui peut se lire comme un roman de formation —,
entre en étroite résonance avec les pages
soigneusement
conservées d'un livre
récupéré par le
héros sur l'épave qui a
accrédité
l'idée du naufrage : quelques fragments de
Parménide
et d'Héraclite. Dans l'appendice intitulé
« L'atelier de l'empreinte »,
Chamoiseau a
réuni quelques chutes
et notes.
Évoquant le poème
parménidien, il note :
« petit soleil obscur qui nous dépose en
face d'un être
impavide » ; puis il mentionne son cher
Héraclite, « qui n'en finit pas de
complexifier le
réel, d'associer les contraires, de relier des antagonismes
dans
une unité de feu » (p. 248).
Ailleurs il fait
référence à d'autres grands
inspirateurs,
Saint-John Perse, Glissant, Césaire, Walcott, Faulkner,
ainsi
que Nietzsche ou Pascal. Il ne manque pas de saluer comme il le
mérite Daniel Defoe, non sans émettre un lourd
regret : « C'est triste : le
Robinson de Defoe était un
négrier »
(p. 241).
|
| EXTRAIT |
un
jour, je croisai une famille d'oppossums ; ils
étaient
d'une espèce jamais vue sur cette île ;
ce genre de
découverte était fréquent ;
les eaux marines
rejetaient sur les rives moult bestioles allogènes, et
celles-ci
se mettaient à foisonner très vite ;
cette famille
était pour ainsi dire complète, père,
mère,
enfants, et même des spécimens
âgés, sans
doute les patriarches ; j'aimais cette idée de
famille ; je pris le gros registre, ouvris une double page
blafarde, sur laquelle je dessinai non pas un arbre
généalogique fictif comme je l'avais
pratiqué bien
des fois — je n'avais plus besoin d'une
origine-bateau ! — mais mon
« arbre
géographique » ; il
désignait les lieux
de l'île qui m'étaient chers, ou que je
préférais pour telle ou telle raison ;
plutôt
que de les nommer à mon ancienne manière
possessive-possédante, je les évoquais avec des
mots
aussi diffus que jasmin,
vent, rêve, plaisir, tendresse, amour, baiser … ;
puis je complétai cet arbre d'un lot de rivages lointains,
côtes, villes, nations, contrées,
terroirs …,
remontés de ma mémoire perdue ou qui avaient
hanté
mes longues songeries du dimanche soir ; puis j'y
plaçai
mon jeune bouc, quelques orchidées, mon chien
défunt, des
perroquets-frères, une sauterelle-cousine, les oppossums, et
mille bestioles-alliées, d'ici ou d'ailleurs, qui faisaient
partie de mes affections ; en contemplant cet arbre, je
croyais
voir un pays singulier, mon
pays, celui
que j'habitais ; il ne se résumait pas à
cette
île mais s'étendait bien au-delà, dans
mes
sentiments, dans mon corps, ma mémoire, mon esprit, et
concrétisait le rapport que la personne que
j'étais
devenu entretenait avec l'idée de l'île, et
même
l'idée du monde qui au-delà m'oubliait ;
☐ La petite personne, pp. 164-165 |
|
| COMPLÉMENT
BIBLIOGRAPHIQUE |
- « L'empreinte
à Crusoé » postface de
Guillaume Pigeard de
Gurbert, Paris : Gallimard (Folio, 5644), 2013
|
- « Manman
Dlo contre la fée Carabosse »,
Paris : Ed. Caribéennes, 1982
- « Chronique
des sept misères », Paris :
Gallimard, 1986 ; Gallimard (Folio, 1965), 1988
- « Solibo
magnifique », Paris : Gallimard,
1988 ; Gallimard (Folio, 2277), 1991
- « Antan d'enfance »,
Paris : Hatier, 1990 ; Gallimard (Haute enfance),
1994 ; Gallimard (Folio, 2843), 1996
- « Texaco »,
Paris : Gallimard, 1992 ; Gallimard (Folio, 2634),
1994
- « Chemin-d'école »,
Paris : Gallimard (Haute enfance), 1994 ; Gallimard (Folio, 2844), 1996
- « Le
dernier coup de dent d'un voleur de banane » et
« Que faire de la parole ? Dans la
tracée
mystérieuse de l'oral à
l'écrit » in
Ralph Ludwig (éd.), Ecrire la
« parole de nuit », Paris :
Gallimard (Folio essais, 239), 1994
- « Guyane :
traces-mémoires du bagne » photographies
de Rodolphe
Hammadi, Paris : CNMHS (Monuments en paroles), 1994
- « Ecrire
en pays dominé », Paris :
Gallimard, 1997 ; Gallimard (Folio, 3677), 2002
- « L'esclave
vieil homme et le molosse » avec un entre-dire
d'Edouard Glissant, Paris : Gallimard, 1997 ;
Gallimard (Folio, 3184), 1999
- « Elmire
des sept bonheurs : confidences d'un vieux travailleur de la
distillerie Saint-Etienne » photographies de
Jean-Luc de Laguarigue, Paris : Gallimard, 1998
- « Cases en
Pays-mêlés »
photographies de Jean-Luc de Laguarigue, Gros-Morne (Martinique), 2000
- « Tracées de
mélancolie » photographies de
Jean-Luc de Laguarigue, Gros-Morne (Martinique) : Traces HSE,
1999 ; Paris : Hazan, 2001
- « Livret
des villes du deuxième monde »,
Paris : Ed. du
Patrimoine (La Ville entière), 2002
- « Bibliques des derniers
gestes », Paris : Gallimard,
2001 ; Gallimard (Folio, 3942), 2003
- « A
bout d'enfance », Paris : Gallimard (Haute
enfance), 2005 ;
Gallimard (Folio, 4430), 2006
- « Trésors
cachés et patrimoine naturel de la Martinique vue du
ciel » photographies d'Anne Chopin, Paris :
HC
éditions, 2007
- « Un
dimanche au cachot », Paris : Gallimard,
2007 ; Gallimard (Folio, 4899), 2009
- « Les
neuf consciences du Malfini », Paris :
Gallimard, 2009 ; Gallimard (Folio, 5160), 2010
- « Le papillon et la lumière »,
Paris : Philippe Rey, 2011
- « La matière de l'absence »,
Paris : Seuil, 2016
- « Frères migrants »,
Paris : Seuil, 2017
- « J'ai
toujours aimé la nuit », Paris :
Sonatine, 2017
- « Contes des sages
créoles », Paris : Seuil, 2018
|
|
|
- Paola
Ghinelli, « Entretien avec Patrick
Chamoiseau », in Archipels
littéraires, Montréal :
Mémoire d'encrier, 2005
- Dominique
Chancé, « Patrick Chamoiseau,
écrivain
postcolonial et baroque », Paris :
Honoré
Chamion (Bibliothèque de littérature
générale et comparée,
82), 2010
- Samia
Kassab-Charfi, « Patrick Chamoiseau »,
Paris : Institut français, Gallimard, 2012
- Isabelle
Constant, « Le Robinson antillais : de
Daniel Defoe
à Patrick Chamoiseau », Paris :
L'Harmattan
(Espaces littéraires), 2015
|
- Daniel
Defoe, « The life and strange surprizing adventures
of
Robinson Crusoe, of York, mariner »,
Londres : W.
Taylor, 1719
- Daniel
Defoe, « Vie et aventures
de Robinson Crusoé »
traduit de l'anglais par Pétrus Borel,
précédé de Les compagnons de Robinson, par
Michel Butor, Paris : P.O.L (La
Collection), 1993
|
| sur le site « île en
île » : dossier Patrick Chamoiseau |
|
|
| mise-à-jour : 3
septembre 2021 |
| Patrick Chamoiseau, « Enrayer la violence en Corse »,
Libération, 27-28 novembre 1999 |
| Patrick Chamoiseau et Edouard Glissant, « Dean est
passé, il faut renaître.
Aprézan ! »,
Le Monde, 26-27 août 2007 |
| Patrick Chamoiseau, « J'ai
vu un peuple s'ébrouer … »,
Le Monde, 14 mars 2009 |
| Patrick Chamoiseau, « Frantz Fanon,
côté sève »,
Le Monde, 11-12 décembre 2011 |
| Patrick Chamoiseau, « Aucune excuse,
aucune sanction, soutien total à M. Letchimy
», 10 février 2012 |
| Patrick Chamoiseau, « Le devenir, c'est
être ensemble, debout, face à l'impensable »,
Le Monde, 16 novembre 2013 |
| Patrick Chamoiseau, « Frères
migrants … Les poètes
déclarent »,
janvier 2017 |
|
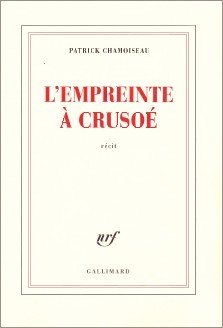 |
|
|
|