|
Noa Noa / Paul
Gauguin ; éd. établie,
annotée et présentée par Pierre Petit
; gravures réunies et commentées par Bronwen
Nicholson. - Paris : Jean-Jacques Pauvert, 1988. - 143 p. :
ill. ; 24 cm.
ISBN 2-87697-030-9
|
|
Teha'amana est
présente dans de nombreux tableaux de Gauguin ; le plus
connu d'entre eux : « Merahi metua no
Tehaamana », soit Teha'amana a beaucoup de
parents (peint en 1893, aujourd'hui à
l'Art Institute de Chicago). Gauguin raconte, dans Noa Noa,
sa rencontre, son « mariage » et
sa courte vie commune avec Teha'amana. En route autour de
l'île, Gauguin avait fait connaissance de la mère
naturelle puis de la mère adoptive de sa
fiancée : Teha'amana a beaucoup de
parents !
Dans « Gauguin à Tahiti et aux
îles Marquises », Bengt
Danielsson souligne l'opposition, déjà
relevée par Gauguin, entre Teha'amana et Rarahu : « Le
mariage de Gauguin est plus réussi que celui de Loti, parce
que Teha'amana est une pure Tahitienne 1, alors que Rarahu,
héroïne fictive, est le prototype de la fille
évoluée de Papeete ».
Rarahu et Teha'amana ont en
commun de ne pas savoir retenir leurs amoureux d'outre-mer ;
mais la différence majeure que l'on peut établir
entre les deux plus célèbres vahine du
dix-neuvième siècle finissant réside
dans leur pouvoir inspirateur et/ou dans le regard porté sur
elles par Loti d'une part, et par Gauguin d'autre part. Rarahu, sous la
plume de Loti, n'est qu'un aimable cliché ;
Teha'amana est vivante : le portrait qu'en trace Gauguin dans Noa
Noa est plus parlant que les images convenues que
véhicule la littérature
« exotique » de
l'époque.
Avec Teha'amana, autour d'elle
et sans doute largement grâce à elle, c'est tout
le Tahiti de l'époque que Gauguin fait revivre dans Noa
Noa : non pas la vie étriquée
de la petite colonie française autour de Papeete, mais la
vie simple des districts. En marge de l'idylle, c'est un
« témoignage
ethnologique » sans équivalent dans la
littérature de l'époque.
| 1. |
Gauguin
croyait Teha'amana originaire des îles Tonga, mais elle
était née à Rarotonga dans les
îles Cook,
à l'ouest de la Polynésie française. |
|
|
JEAN-JO
SCEMLA :
Des nombreux textes écrits par Gauguin, seul Noa
Noa restitue son expérience tahitienne sous forme
de récit. Il en entreprend la rédaction
à Paris, à l'automne 1893, au retour de son
premier voyage en Océanie. Il veut tout raconter : Tahiti,
son peuple, sa culture, Teha'amana, la femme enfant avec qui il connut
à Mataiea l'une des périodes les plus heureuses
et les plus productives de son séjour, la
« trivialité » des
Européens de Papeete, son évolution de
l'état de civilisé à celui de sauvage
(oviri), terme qu'il revendiquait hautement. Il ne doute pas que sa
relation intéressera un large public, aussi, pour en assurer
la réussite, confie-t-il la mise en forme
définitive de ses notes à son ami, le
poète symboliste Charles Morice. La perspective de
renouveler le succès du Mariage de Loti le
conduit également à arranger la
réalité. Il ne mentionne jamais ses ennuis de
santé ou ses soucis d'argent pourtant
réitérés dans chacune de ses lettres
à Daniel de Monfreid. Il nous fait croire à sa
parfaite connaissance de la langue tahitienne, mais ses transcriptions
sont presque toujours erronées. Il prétend,
enfin, avoir appris les légendes tahitiennes de Teha'amana
alors qu'il les tient de sa lecture de Voyage aux îles
du Grand Océan de J.A. Moerenhout. Des
passages entiers de ce livres sont recopiés dans son Ancien
Culte mahorie. « Quelle religion
que l'ancienne religion océanienne. Quelle
merveille ! mon cerveau en claque »,
écrit-il à Sérusier le 25 mars 1892,
après avoir découvert l'ouvrage de Moerenhout
dans la bibliothèque de Me
Goupil (Segalen consultera le même exemplaire en 1903).
Malgré ses omissions et ses embellissements, Noa
Noa apparaît comme l'un des textes les plus
spontanés et les plus authentiques sur la
Polynésie. Entier et direct, comme à son
habitude, Gauguin y livre ses pensées les plus
secrètes et montre une sincère sympathie pour les
Tahitiens et leur culture. D'un style âpre et incisif,
parfois télégraphique comme s'il était
pressé, il malmène les mots non sans
révéler un grand sens de la formule. C'est
pourquoi ses premières notes, peu travaillées et
brouillonnes, paraissent plus pertinentes que le texte
peaufiné par Morice
et surchargé de ses redondances lyriques
(édité en 1901).
Gauguin remit en 1894 son
manuscrit à Morice qui le travailla et finit une
première version en 1895. Gauguin repartit donc à
Tahiti avec son texte remanié par le poète et le
recopia de sa main en y ajoutant des illustrations. Une copie
aujourd'hui déposée au cabinet des dessins du
Louvre a souvent été confondue avec le manuscrit
original, qui avait disparu pendant un demi-siècle et fut
retrouvé en 1951 par le libraire Jean Loize dans le grenier
de son confrère Edmond Sagot qui l'avait acheté
lui-même à Morice en 1908. Un
fac-similé en fut tiré en 1954, puis Jean Loize
transcrivit le texte dans une savante édition en 1966. Le
manuscrit fut ensuite mis aux enchères à Drouot
et acquis par Gilles Artur, conservateur depuis vingt ans du
musée Gauguin à Tahiti. Ce dernier en tira en
1987 un nouveau fac-similé enrichi des illustration
réalisées par Gauguin sur sa copie de 1895.
Enfin, Pierre Petit établit en 1988 une nouvelle version
corrigeant les quelques « erreurs de
lecture » et la « ponctuation
hésitante » de Jean Loize. Le manuscrit a
depuis été revendu à la fondation Paul
Getty.
☐
Le Voyage
en Polynésie, Anthologie des voyageurs occidentaux de Cook
à Segalen,
pp. 1156-1157
|
| COMPLÉMENT
BIBLIOGRAPHIQUE |
- « Noa
Noa » manuscrit inédit reproduit en
fac-similé
par Daniel Jacomet, Paris : Sagot-Le Garrec, 1954
- « Noa
Noa » éd. Jean Loize, Paris :
Club des libraires de France-André Balland, 1966
- « Noa Noa »
éd. réalisée et
présentée par Gilles Artur, Jean-Pierre Fourcade
et Jean-Pierre Zingg, Papeete & New York :
Éd. Avant et après, 1987, 2001
|
- « Noa Noa »
[d'après la version publiée par Charles Morice
dans La revue blanche en
1897], Paris : Éd. Mille et une nuits, 1998
- « Noa Noa, voyage de Tahiti »
fac-sim. du manuscrit déposé au Louvre,
Paris : Les
Éd. Rmn-Grand Palais, Les Éd. du Musée
d'Orsay,
2017
|
|
|
| mise-à-jour : 10
janvier 2018 |
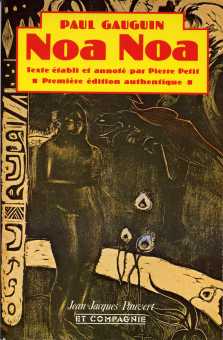
|
|
|
|